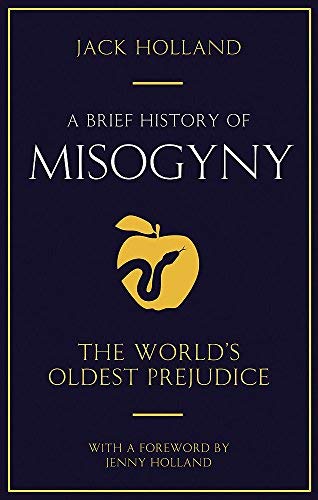Points clés
1. Les origines antiques de la misogynie : accuser la femme de la chute de l’humanité
De la femme vient toute la race féminine, La race mortelle et funeste des épouses Qui vivent avec les hommes et leur causent du tort.
Origines mythologiques. La misogynie, cette haine des femmes, trouve ses racines les plus anciennes au VIIIe siècle avant notre ère, apparaissant simultanément en Grèce antique et en Judée. Ces deux civilisations ont forgé des mythes puissants de la création qui imputaient aux femmes la responsabilité des souffrances, des malheurs et de la mort humaine. Ces récits, mettant en scène des figures telles que Pandore et Ève, ont établi la croyance fondamentale selon laquelle la femme serait une pensée malveillante, une punition infligée à l’homme pour son orgueil ou sa désobéissance.
Punition pour orgueil. Dans le mythe grec d’Hésiode, Pandore, « la donneuse de tout » et « belle calamité », est le cadeau vengeur de Zeus aux hommes après que Prométhée ait dérobé le feu. Sa curiosité la pousse à ouvrir un vase scellé, libérant ainsi tous les maux et douleurs sur l’humanité, condamnant les hommes au travail, à la maladie et à la mort. De même, le récit juif de la Genèse présente Ève comme la première à désobéir à Dieu en mangeant du fruit de l’Arbre de la Connaissance, entraînant l’expulsion du paradis et la malédiction de la douleur dans la conception ainsi que la domination masculine.
Début de la déshumanisation. Ces mythes justifiaient l’ordre patriarcal en place, dépeignant les femmes comme intrinsèquement défectueuses et responsables de la chute de l’homme. Ils instaurèrent une vision dualiste où la femme, incarnation de la nature et de ses limites, devenait « l’Autre », un rappel constant de la mortalité masculine et une cible de déshumanisation, alors même qu’elle était indispensable à la survie de l’espèce humaine.
2. Fondements philosophiques et scientifiques de l’infériorité féminine
La femelle est, pour ainsi dire, un mâle mutilé.
Le dualisme platonicien. La philosophie grecque antique, notamment la théorie des Formes de Platon, offrit un cadre intellectuel puissant à la misogynie. Platon, qui ne se maria jamais et exalta l’amour entre hommes, considérait le monde sensible, mutable, incluant le mariage et la procréation, comme une illusion et une distraction de la Vérité absolue (Beauté et Bonté parfaites). Il associait les femmes à ce monde inférieur et charnel, posant ainsi les bases philosophiques des doctrines chrétiennes ultérieures qui méprisaient le monde physique.
La « science » d’Aristote. Élève de Platon, Aristote renforça ces vues misogynes par ses théories « scientifiques ». Il affirmait que le mâle était supérieur par nature, portant l’âme et le potentiel humain complet dans son sperme, tandis que la femelle n’apportait qu’une matière passive. Si un enfant naissait femelle, c’était à cause de la « constitution froide » de la mère, faisant des femmes des « mâles mutilés » incapables d’atteindre leur plein potentiel humain.
Justification de l’inégalité. Ces arguments philosophiques et scientifiques, malgré leur absurdité, dominèrent la pensée occidentale pendant près de deux millénaires. Ils fournissaient une justification apparemment rationnelle à la subjugation des femmes, codifiant leur « infériorité inhérente » et renforçant le dualisme qui plaçait l’homme en thèse et la femme en antithèse, enfermées dans une lutte où la femme incarnait le méprisable.
3. La défiance publique des femmes romaines et la réaction patriarcale
La femme est un animal violent et incontrôlable, et il ne sert à rien de lui donner les rênes en espérant qu’elle ne les brisera pas.
Remise en cause des normes. Contrairement à leurs homologues grecques confinées, les femmes romaines, surtout issues des classes supérieures, contestèrent activement la misogynie dominante et s’imposèrent dans la sphère publique. Elles protestèrent contre les politiques gouvernementales, intervinrent dans les guerres et participèrent même à des intrigues politiques, inscrivant leur nom dans l’Histoire. Cette visibilité et cette assurance publiques contrastaient fortement avec l’idéal de la femme athénienne silencieuse et anonyme.
L’avertissement de Caton. Cette montée en puissance féminine suscita une vive réaction patriarcale. Des figures comme Caton l’Ancien s’opposèrent farouchement à la présence publique des femmes, avertissant que leur liberté mènerait à la décadence morale et à leur domination sur les hommes. Sa rhétorique, assimilant les femmes à des « animaux violents et incontrôlables », devint un modèle pour les arguments misogynes futurs contre l’émancipation féminine.
Contrôle impérial. L’avènement de l’Empire romain sous Auguste fut marqué par un effort concerté pour restaurer les « valeurs familiales traditionnelles » à travers des lois telles que la Lex Julia, qui punissait sévèrement l’adultère féminin et renforçait l’autorité masculine. Des femmes comme Julia, fille d’Auguste, et Messaline, épouse de l’empereur Claude, devinrent des symboles notoires de la « licence » féminine et de « l’ambition démesurée », leurs histoires amplifiées par des historiens et satiristes masculins pour mettre en garde contre l’influence des femmes.
4. La déification et la diabolisation contradictoires des femmes par le christianisme
Tu es la porte du diable : tu es celle qui a déverrouillé l’arbre interdit : tu es la première à avoir déserté la loi divine : c’est toi qui as persuadé celui que le diable n’osait attaquer.
Honte héritée. Le christianisme intégra les concepts juifs du péché et de la honte, notamment le mythe de la Chute, qui façonna profondément sa vision des femmes. Si les enseignements de Jésus témoignaient d’une sympathie remarquable envers elles, l’Église primitive, influencée par des figures comme saint Paul et Tertullien, développa une hostilité profonde envers le corps humain et la sexualité, les considérant comme intrinsèquement mauvais et sources de tentation.
La condamnation de Tertullien. Tertullien, Père de l’Église fondamental, déclara fameusement que les femmes étaient la « porte du diable », les tenant responsables non seulement de la Chute mais aussi de la nécessité de la mort du Christ. Cette rhétorique extrême associait la sexualité féminine au péché et à la damnation, affirmant que l’ornementation et même l’existence des femmes détournaient de la pureté spirituelle, exigeant ainsi leur modestie et leur soumission.
Le paradoxe de Marie. Parallèlement, l’Église catholique éleva Marie, mère de Jésus, à un statut sans précédent de Mère de Dieu et Reine du Ciel. Cette déification se fit cependant au prix de sa sexualité, puisqu’elle fut déclarée vierge perpétuelle et conçue sans péché originel. Marie devint un idéal inaccessible, son absence de sexualité constituant un reproche à la nature humaine des autres femmes, perpétuant une vision dualiste où les femmes étaient soit d’une pureté impossible, soit intrinsèquement pécheresses.
5. Les chasses aux sorcières : la manifestation la plus meurtrière de la misogynie
Toute sorcellerie vient de la luxure charnelle, qui est insatiable chez les femmes.
Un tournant mortel. La fin du Moyen Âge vit la manifestation la plus horrible de la misogynie : la chasse aux sorcières, qui conduisit à la torture et à l’exécution de centaines de milliers de femmes à travers l’Europe. Cette période marqua un changement radical par rapport aux vues antérieures de l’Église, qui considérait la sorcellerie comme superstition, alimentée par une peur omniprésente, le doute et une obsession renouvelée de l’influence du Diable.
Le « Marteau des sorcières ». La publication du Malleus Maleficarum (Marteau des sorcières) en 1487, facilitée par l’imprimerie, associa explicitement les faiblesses supposées des femmes — vanité, faiblesse d’esprit, bavardage — à leur vulnérabilité aux tentations diaboliques. Il affirmait que la « luxure charnelle insatiable » des femmes était la cause principale de leur transformation en sorcières, participant à des relations démoniaques et à de vastes conspirations contre la société chrétienne.
Terreur institutionnalisée. L’Inquisition, avec l’aval papal, devint un instrument de terreur, recourant à la torture, à la tromperie et à l’humiliation publique pour extorquer des aveux. Les femmes accusées étaient déshabillées, rasées et soumises à des supplices brutaux comme le strappado, souvent mortes avant leur procès. Cette période illustre de manière glaçante comment des arguments abstraits sur la nature féminine, conjugués aux angoisses sociales, pouvaient conduire à une persécution et un meurtre de masse, ciblant de manière disproportionnée les femmes.
6. L’aube de la modernité : idéaux des Lumières contre oppression persistante
Si tous les hommes naissent libres, comment se fait-il que toutes les femmes naissent esclaves ?
Remise en cause de l’autorité. Les révolutions intellectuelles, sociales et politiques des XVIe au XVIIIe siècles, incluant la Réforme et les Lumières, commencèrent à contester les autorités traditionnelles qui soutenaient la misogynie. L’accent protestant sur la lecture individuelle de la Bible favorisa involontairement l’alphabétisation des femmes, tandis que des philosophes comme John Locke introduisirent des idées révolutionnaires d’autonomie individuelle, d’égalité et de recherche du bonheur, remettant en question la subordination « naturelle » des femmes.
L’appel de Mary Wollstonecraft. La question poignante de Mary Astell, « Si tous les hommes naissent libres, comment se fait-il que toutes les femmes naissent esclaves ? », résumait la tension croissante entre les idéaux des Lumières et la subjugation juridique et sociale persistante des femmes. Mary Wollstonecraft, dans Défense des droits de la femme (1792), soutint que les prétendues faiblesses féminines résultaient d’un manque d’éducation, non d’une nature inhérente, plaidant pour la raison comme voie d’émancipation.
Contradictions persistantes. Malgré ces évolutions intellectuelles, la misogynie resta tenace. Les réformes légales en faveur des droits des femmes furent lentes, et les préjugés traditionnels perdurèrent. L’essor du roman offrit cependant de nouvelles voies pour explorer la vie intérieure des femmes et défier les stéréotypes, comme dans Roxana de Daniel Defoe, qui dépeint une femme autonome défiant les rôles conventionnels, tandis que d’autres œuvres populaires, telles que Pamela de Richardson, renforçaient l’idéal de la femme chaste et vertueuse.
7. Paradoxes victoriens : anges asexués et prostituées dégradées
La majorité des femmes (heureusement pour la société) ne sont guère troublées par des sentiments sexuels quelconques.
Impact industriel. La Révolution industrielle transforma profondément la vie des femmes, attirant des millions d’entre elles dans les usines et les quartiers pauvres urbains, où elles affrontaient pauvreté extrême, exploitation et violences. Malgré leur travail essentiel, elles étaient payées bien moins que les hommes et supportaient la double charge du travail et des responsabilités domestiques, recourant souvent à la prostitution pour survivre.
Dichotomie sexuelle. La société victorienne, surtout la classe moyenne, développa une dichotomie sexuelle marquée : « l’Ange du Foyer », épouse et mère pure et asexuée, contrastait violemment avec la « femme déchue » ou prostituée, perçue comme animée par un désir sexuel incontrôlable. Des « experts » médicaux comme le Dr William Acton propagèrent le mythe de l’asexualité féminine, avertissant que le plaisir sexuel chez la femme menait à la maladie ou à la folie, allant jusqu’à préconiser la clitoridectomie pour « guérir » masturbation ou nymphomanie.
Reflets littéraires et sociaux. Ce déni de la sexualité féminine imprégna la littérature, avec des auteurs majeurs comme Charles Dickens évitant les descriptions érotiques et célébrant l’innocence enfantine. La prévalence de la prostitution infantile, conjuguée au culte sentimental de la « petite fille », révéla une incapacité troublante des hommes victoriens à reconnaître la sexualité féminine adulte, conduisant à la dégradation et à l’humiliation des femmes ne correspondant pas à l’idéal asexué.
8. Totalitarismes du XXe siècle : misogynie « scientifique » et contrôle étatique
Le bonheur de l’homme est : « Je veux. » Le bonheur de la femme est : « Il veut. »
L’influence de Freud. Le début du XXe siècle vit la résurgence de la misogynie sous des justifications « scientifiques ». Sigmund Freud, malgré son influence, perpétua des vues misogynes, affirmant que la sexualité féminine était un « continent noir » et que la féminité nécessitait « l’élimination de la sexualité clitoridienne », enracinée dans « l’envie du pénis ». Ses théories, fondées sur des preuves limitées, renforcèrent l’idée des femmes comme « mâles mutilés » et ennemies de la civilisation.
Le « Surhomme » de Nietzsche. Des philosophes comme Otto Weininger, influencés par Nietzsche, portèrent la misogynie à des niveaux extrêmes et mystiques, niant l’existence même des femmes et les réduisant à « rien », simples matières soumises à la volonté masculine. Cette vision, mêlant antisémitisme et misogynie, trouva un terrain fertile dans la Vienne du tournant du siècle, influençant des figures telles qu’Adolf Hitler.
Contrôle totalitaire. L’Allemagne nazie et les régimes communistes (Union soviétique, Chine maoïste, Corée du Nord) imposèrent systématiquement des politiques misogynes, considérant le corps des femmes comme un instrument de contrôle étatique. Ils interdirent la contraception, forcèrent les avortements, dictèrent les codes vestimentaires et confinèrent les femmes à des rôles domestiques ou reproductifs, souvent sous couvert de « libération » ou de pureté raciale. Cela démontra comment le totalitarisme, quelle que soit son idéologie, révèle ses aspects les plus terrifiants par la maltraitance systématique des femmes.
9. Guerre et misogynie : le viol comme arme d’humiliation
L’exploitation sexuelle des femmes noires pendant l’esclavage fut aussi dévastatrice que l’émasculation des esclaves noirs masculins.
Précédent historique. À travers l’Histoire, la guerre a offert un contexte brutal à la misogynie, le viol servant non seulement de soulagement sexuel aux soldats, mais aussi d’arme délibérée d’humiliation contre les populations ennemies. De l’exploitation sexuelle des femmes afro-américaines réduites en esclavage aux viols de masse lors du massacre de Nankin en 1937, les femmes furent systématiquement ciblées pour des cruautés particulières en temps de conflit.
Nettoyage ethnique. Les guerres civiles dans l’ex-Yougoslavie dans les années 1990 virent l’établissement de camps de viol où des femmes musulmanes et croates furent violées et enceintes de force. Cette stratégie délibérée de « nettoyage ethnique » visait à détruire l’identité de l’ennemi en forçant les femmes à porter des enfants de l’ethnie agresseur, fondée sur la croyance misogyne que l’homme détermine l’identité de l’enfant.
Double fardeau. Les femmes survivantes de ces atrocités faisaient souvent face au rejet communautaire, portant un double fardeau de traumatisme personnel et de stigmatisation sociale. Cela souligne comment l’identification de la vertu féminine à l’honneur familial ou national les condamne deux fois pour des actes hors de leur contrôle, révélant la misogynie profonde qui accompagne les haines raciales et religieuses en temps de guerre.
10. L’énigme persistante : la nature omniprésente et protéiforme de la misogynie
La misogynie, comme l’antisémitisme, est « hors de proportion avec tout conflit objectif ou social ».
Omniprésente et persistante. La misogynie demeure un préjugé omniprésent et tenace, souvent invisible car enraciné dans le « bon sens » de la société. Des mythes antiques aux paroles des rappeurs contemporains, elle s’adapte et se reproduit à travers les cultures, se manifestant sous forme de discrimination sociale, de subjugation légale ou de rage meurtrière de psychopathes comme Jack l’Éventreur. Sa nature durable, à la différence d’autres préjugés, provient de l’intimité complexe et inévitable entre hommes et femmes.
L’« Autre » qu’on ne peut exclure. Au fond, la misogynie naît de la peur masculine de la différence féminine et de la menace perçue à l’autonomie masculine. Les femmes sont « l’Autre » originel, mais ne peuvent être exclues, car l’existence humaine dépend de leur interaction. Cette peur d’être englouti ou
Dernière mise à jour:
Avis
Une brève histoire de la misogynie reçoit des critiques élogieuses pour son exploration rigoureuse et chronologique de la misogynie à travers les âges. Les lecteurs saluent l’approche impartiale de l’auteur ainsi que la richesse de ses recherches, même si certains ont trouvé le contenu parfois difficile à affronter. L’ouvrage est reconnu pour sa valeur éducative et sa capacité à susciter une réflexion profonde sur les enjeux sociétaux actuels. Les critiques soulignent qu’il aborde diverses figures influentes tout en analysant les dimensions religieuses et politiques. Bien qu’il ne soit pas une lecture aisée, ce livre est vivement recommandé pour son examen perspicace du plus ancien des préjugés.