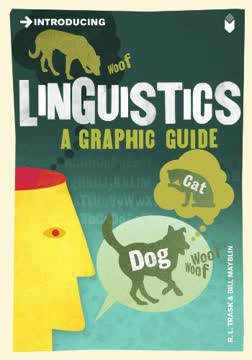Points clés
1. La linguistique : un voyage scientifique au cœur de la structure du langage
Les êtres humains parlent sans doute depuis aussi longtemps qu’ils existent, mais ce n’est qu’il y a environ 3 000 ans que l’on a commencé à s’interroger sur la langue et à l’étudier de manière systématique.
Des racines anciennes. L’étude systématique du langage, la linguistique, a vu le jour indépendamment en Inde ancienne et en Grèce. Pāṇini, linguiste indien du Ve siècle avant J.-C., a élaboré une approche sophistiquée et fondée sur des règles pour la grammaire du sanskrit, anticipant de manière remarquable la linguistique formelle moderne. En Europe, des savants grecs tels qu’Aristote et Dionysius Thrax ont posé les bases de la description grammaticale, en classant les mots en « parties du discours », un système repris et adapté par les grammairiens romains pour le latin, notamment Priscien.
Un changement de perspective. Pendant des siècles, la grammaire européenne fut essentiellement prescriptive, cherchant à imposer les structures latines aux autres langues et à dicter un usage « correct ». Cependant, au XVIIe siècle, le Cercle de Port-Royal introduisit une approche plus universelle et philosophique, reconnaissant que les locuteurs font un « usage infini de ressources finies » du langage. À la fin du XVIIIe siècle, la linguistique historique émergea, révélant des ressemblances systématiques entre les langues, conduisant à la découverte de familles linguistiques comme l’indo-européen, éclipsant temporairement d’autres recherches linguistiques.
La linguistique générale moderne. À la fin du XIXe siècle, l’étude non historique de la structure du langage refit surface, donnant naissance à ce que l’on appelle aujourd’hui la linguistique générale — l’étude de la manière dont les langues sont construites et fonctionnent. Ce tournant marqua une orientation vers le descriptivisme, où les linguistes cherchent à enregistrer et décrire la langue telle qu’elle est réellement utilisée, plutôt que de prescrire comment elle devrait l’être. Cette approche scientifique et empirique constitue le socle de la recherche linguistique contemporaine, visant à comprendre les systèmes sous-jacents de la communication humaine.
2. Le langage comme système structuré : l’héritage durable de Saussure
Cette approche novatrice fut rapidement qualifiée de structuralisme et, depuis les travaux de Saussure, presque toutes les recherches majeures sur les langues ont été structuralistes dans ce sens.
La révolution structuraliste. Ferdinand de Saussure, linguiste suisse, révolutionna le domaine en proposant une approche structuraliste du langage. Avant lui, les linguistes considéraient souvent la langue de manière atomistique, comme un ensemble de sons ou de mots isolés. Saussure soutint que le langage est un système ordonné, ou un « système de systèmes », où le sens et la fonction des unités linguistiques se définissent par leurs relations et oppositions au sein de la structure globale, et non par leurs propriétés intrinsèques.
Phonèmes et signification. Un concept clé du structuralisme est le phonème, la plus petite unité sonore capable de distinguer le sens dans une langue. Par exemple, en anglais, /d/ et /ð/ sont des phonèmes distincts car « den » et « then » ont des significations différentes. En revanche, en espagnol, [d] et [ð] sont des variantes d’un même phonème, leur occurrence étant prévisible selon la position sans changer le sens. Cela souligne que c’est la relation structurelle des sons qui importe, et non leurs caractéristiques phonétiques objectives.
Synchronie vs diachronie. Saussure mit aussi en lumière la distinction entre approche synchronique et diachronique. L’étude synchronique analyse la structure d’une langue à un moment donné, en se concentrant sur son système interne. L’étude diachronique, au contraire, examine l’évolution et les changements d’une langue au fil du temps. Alors que la linguistique historique s’intéresse à la diachronie, le structuralisme de Saussure offrit un cadre pour comprendre la nature systématique du langage à un instant donné, influençant des écoles ultérieures comme le Cercle de Prague et le structuralisme américain.
3. La faculté innée du langage humain : un impératif biologique
En réalité, beaucoup soutiennent que notre possession unique du langage est la caractéristique la plus importante que nous ayons, celle qui nous distingue le plus nettement de toutes les autres espèces.
Définir la langue naturelle. Les linguistes définissent la « langue naturelle » comme toute langue qui est, ou a été, la langue maternelle d’un groupe d’êtres humains. Cela inclut plus de 6 500 langues dans le monde, indépendamment du nombre de locuteurs, du statut politique ou de la présence d’une tradition écrite. Pour les linguistes, toutes les langues naturelles ont une valeur égale pour comprendre les propriétés universelles de la communication humaine, qui forment collectivement ce que l’on appelle le « langage » ou notre « faculté langagière ».
Caractéristiques uniques. Les langues humaines possèdent des « traits de conception » distincts absents des systèmes de communication animale, identifiés par Charles Hockett. Parmi eux :
- Vocabulaire vaste : des milliers de mots et des mécanismes pour en créer de nouveaux.
- Modification morphologique : moyens de changer le sens des mots (temps, pluriel).
- Négation et questions : capacité d’exprimer la négation et de poser des questions.
- Abstraction : concepts comme la « rougeur » ou « l’absence ».
- Déplacement : parler de choses absentes dans le temps ou l’espace.
- Ouverture : produire et comprendre des énoncés inédits sans effort.
- Liberté de stimulus : pouvoir dire n’importe quoi, ou rien, en toute circonstance.
Ces capacités sont universelles chez l’humain, du professeur au membre d’une tribu de l’âge de pierre, soulignant le langage comme un trait spécifiquement humain.
Preuves issues des créoles. La capacité innée au langage se manifeste puissamment dans l’émergence des pidgins et créoles. Lorsque des locuteurs de langues différentes doivent communiquer, ils développent un « pidgin » rudimentaire, au vocabulaire et à la grammaire limités. Crucialement, les enfants exposés à ce pidgin comme langue principale le transforment spontanément en un « créole » complexe et grammaticalement complet, créant une nouvelle langue naturelle. Cela, ainsi que le développement de la langue des signes nicaraguayenne par des enfants sourds, constitue une preuve convaincante que les humains naissent avec une « pulsion langagière » biologique pour construire et utiliser le langage, un principe fondamental de la Grammaire Universelle de Noam Chomsky.
4. Le langage est dynamique : changement et variation constants
Le changement linguistique est incessant et implacable, provoquant une divergence quasi illimitée des langues par rapport à leurs formes antérieures.
Une langue en perpétuelle évolution. Les langues ne sont pas des entités figées ; elles évoluent constamment, jour après jour, génération après génération. Cette évolution continue entraîne une divergence importante au fil du temps, rendant les formes anciennes d’une langue, comme l’anglais ancien, presque méconnaissables pour les locuteurs modernes. Ces changements touchent la prononciation, le vocabulaire et la grammaire, et constituent un processus naturel et permanent dans toutes les langues vivantes.
Prescriptivisme vs descriptivisme. Cette évolution constante entre souvent en conflit avec le « prescriptivisme », une attitude conservatrice qui cherche à maintenir la langue telle qu’elle était dans une génération précédente, dénonçant fréquemment les nouvelles formes. Historiquement, ces protestations se sont révélées vaines, car des tournures comme « My house is being painted » finissent par être acceptées comme standards. Les linguistes adoptent généralement une posture « descriptiviste », visant à enregistrer et décrire la langue telle qu’elle est réellement utilisée, plutôt que d’imposer des normes.
La variation, moteur du changement. La clé pour comprendre le changement linguistique réside dans la « variation ». À un moment donné, des formes anciennes et nouvelles d’un trait linguistique coexistent, certains locuteurs ou contextes privilégiant l’une ou l’autre. Progressivement, la forme nouvelle devient plus fréquente jusqu’à ce que l’ancienne disparaisse. Cette variation se manifeste aussi entre groupes sociaux (hommes vs femmes, professions différentes) et contextes, montrant qu’une même personne parle différemment selon les circonstances. La sociolinguistique étudie ces variations omniprésentes et leur rôle dans l’évolution du langage et l’identité sociale.
5. Le sens au-delà des mots : le pouvoir du contexte et de la cognition
L’étude de la manière dont nous extrayons des significations communicatives du contexte des énoncés s’appelle désormais la pragmatique.
Sémantique : le sens intrinsèque. La sémantique étudie les significations inhérentes aux formes linguistiques, indépendamment du contexte. Pourtant, définir rigoureusement même des mots simples comme « chien » s’avère étonnamment complexe, car les significations sont souvent floues et dépendent des liens avec d’autres mots. Cette complexité conduisit certains structuralistes américains à exclure temporairement la sémantique de la linguistique, avant qu’elle ne soit réintégrée.
Pragmatique : le sens contextuel. En revanche, la pragmatique s’intéresse à la façon dont nous déduisons des significations communicatives à partir du contexte des énoncés. Cela dépasse le sens littéral des mots. Par exemple, « Susie’s on antibiotics » dans le contexte de la recherche d’un chauffeur pour une fête de Noël implique que « Susie peut conduire ». Cette interprétation repose sur des connaissances partagées (les fêtes impliquent de boire, les antibiotiques interdisent l’alcool, les non-buveurs peuvent conduire). Les maximes de Paul Grice, comme celles de pertinence et de quantité, expliquent comment les auditeurs supposent une coopération et infèrent des significations non exprimées.
Linguistique cognitive : perception et métaphore. La linguistique cognitive offre une autre perspective, reliant la structure et la fonction du langage à la perception et à la cognition humaines. Elle explore comment notre compréhension du monde façonne notre langage. Par exemple, la métaphore anglaise du temps comme entité immobile que nous traversons (« le futur est devant ») contraste avec la vision grecque antique du temps qui passe devant nous (« le passé est devant »). Cette approche souligne le rôle central de la « métaphore cognitive » dans l’expression linguistique, suggérant que beaucoup de langage repose sur des correspondances métaphoriques entre expériences concrètes et concepts abstraits.
6. Les enfants construisent activement les règles du langage
Ces observations montrent clairement que l’enfant ne procède pas par mémorisation ou imitation. Il construit des règles.
Au-delà de l’imitation. Les premières théories, comme celle de B.F. Skinner, supposaient que les enfants acquièrent la langue par imitation et renforcement. Cependant, Noam Chomsky critiqua vivement cette vision, et des recherches ultérieures démontrèrent que les enfants construisent activement des règles linguistiques plutôt que de simplement imiter. Ils ne produisent pas d’erreurs aléatoires ; leurs erreurs révèlent souvent un système sous-jacent régi par des règles en cours de développement.
Un développement régi par des règles. L’acquisition des temps passés en anglais illustre cela :
- D’abord, les enfants apprennent les formes irrégulières fréquentes (ex. « saw », « took »).
- Puis, ils découvrent la règle régulière en « -ed » et la surgénéralisent (ex. « taked », « goed »).
- Enfin, ils apprennent les exceptions et utilisent correctement formes régulières et irrégulières.
De même, dans l’acquisition de la négation, les enfants passent par des étapes, de « No I want milk » à « I no want milk » puis « I don’t want milk », montrant une construction systématique des règles grammaticales.
Le test du « wug » et la faculté innée. Le test du « wug » fournit une preuve convaincante de la construction de règles : les enfants forment correctement le pluriel d’un mot nouveau et inventé (« wug » devient « wugs »), prouvant qu’ils ont intériorisé une règle, et non simplement mémorisé des mots. Cette construction active, associée à la capacité universelle de tous les enfants en bonne santé à acquérir une première langue (même en l’absence d’un input linguistique complet, comme avec les créoles), suggère fortement une « faculté langagière biologique » innée. Cette faculté, concept central de la Grammaire Universelle de Chomsky, prédispose l’humain à acquérir le langage, ne nécessitant qu’une stimulation environnementale minimale.
7. Le plan cérébral du langage : enseignements issus des troubles du langage
Le langage perturbé par des lésions cérébrales s’appelle aphasie (ou dysphasie), et plusieurs types différents sont connus.
Lien cerveau-langage. Notre capacité langagière est étroitement liée à des zones spécifiques du cerveau. Une lésion dans ces zones peut provoquer une « aphasie », un trouble du langage. Dans les années 1860, Paul Broca identifia l’« aphasie de Broca », caractérisée par un discours lent et laborieux, pauvre en grammaire, liée à une lésion de l’aire de Broca (lobe frontal gauche), confirmant son rôle dans la structure grammaticale et le contrôle moteur de la parole.
L’aire de Wernicke et la compréhension. Une décennie plus tard, Carl Wernicke identifia l’« aphasie de Wernicke », où les patients parlent couramment mais de manière incohérente, avec une compréhension altérée. Cette aphasie fut associée à une lésion de l’aire de Wernicke (lobe temporal gauche), suggérant son rôle dans la compréhension du langage et l’accès au vocabulaire. Ces découvertes posèrent les bases de la « neurolinguistique », l’étude du fonctionnement du langage dans le cerveau.
Déficits spécifiques et liens génétiques. La neurolinguistique moderne, grâce aux scanners cérébraux, a confirmé et approfondi ces résultats, révélant des déficits linguistiques très spécifiques. Par exemple, certains patients perdent uniquement les mots désignant les fruits, ou les verbes mais pas les noms. Le « trouble spécifique du langage (TSL) » est une maladie génétique où les individus ont des difficultés avec les mots grammaticaux et les règles, échouant au test du « wug », suggérant un déficit dans la « composante règle » du langage. À l’inverse, les personnes atteintes du syndrome de Williams, malgré une déficience mentale sévère, acquièrent facilement les règles linguistiques mais peinent à retrouver les mots, indiquant une composante distincte de « stockage/accès ». Ces observations, comme le souligne le psycholinguiste Steven Pinker, suggèrent que notre faculté langagière comprend des composantes distinctes basées sur les règles et la mémoire, avec des défauts génétiques pouvant cibler des aspects spécifiques.
8. Déchiffrer les origines et les multiples fonctions du langage
Mais cela ne signifie pas que nous soyons beaucoup plus près de répondre à la question de comment, quand ou pourquoi le langage a commencé.
Un tabou historique. Pendant longtemps, l’origine du langage fut un sujet tabou en linguistique, en grande partie faute de données significatives sur la structure du langage, le fonctionnement cérébral ou l’ascendance humaine. Malgré les progrès actuels dans ces domaines, aucun consensus n’a émergé sur le comment, le quand ou le pourquoi du langage, les spécialistes de diverses disciplines proposant des hypothèses souvent contradictoires.
Théories divergentes sur l’origine. Les théories sur l’origine du langage sont très variées :
- Théorie gradualiste : le langage serait apparu lentement, par petits pas, sous l’effet de la sélection naturelle (Pinker & Bloom). Les critiques soulignent la difficulté d’imaginer une « langue partielle » (ex. noms sans verbes), car de tels systèmes n’existent pas dans la nature, sauf les pidgins.
- Théorie catastrophique : le langage serait né soudainement, « du jour au lendemain », passant d’un « protolangage » rudimentaire (comme les pidgins ou le langage enfantin précoce) à une langue humaine complète, grâce à une connexion cérébrale cruciale (Derek Bickerton).
- Autres hypothèses : le langage aurait émergé des gestes, ou du toilettage vocal.
Les données disponibles, de l’archéologie aux crânes fossiles, pointent dans des directions diverses, empêchant une théorie unifiée.
Les multiples fonctions du langage. Il est peu probable que le langage ait évolué pour une seule fonction. Il remplit au contraire une multitude de rôles, bien au-delà du simple transfert d’informations :
- Communication : transmettre des informations, persuader, convaincre.
- Lien social : entretenir des relations, exprimer son individualité, afficher un statut social.
- Cognition : organiser le monde, construire des représentations mentales.
- Expression : divertir, amuser, exprimer des émotions.
Le langage est profondément ancré dans l’existence humaine, nous distinguant des autres espèces, et sa richesse suggère qu’il a évolué pour répondre à des besoins multiples et interconnectés, plutôt que comme une découverte fortuite d’utilité unique.
Dernière mise à jour:
Avis
Introduction à la linguistique est salué comme une introduction captivante et accessible à ce domaine, les lecteurs appréciant son aperçu concis et ses illustrations ludiques. Beaucoup l'ont trouvé utile pour les débutants ou comme remise à niveau. Certains ont critiqué sa brièveté et des exemples un peu datés, tandis que d'autres ont souligné la clarté de ses explications sur les concepts linguistiques. L’ouvrage aborde divers aspects du langage, de la grammaire à la sémantique, tout en présentant les théories clés et les linguistes majeurs. En général, les lecteurs le recommandent comme point de départ pour ceux qui s’intéressent à la linguistique, même si certains auraient souhaité un approfondissement sur certains sujets.