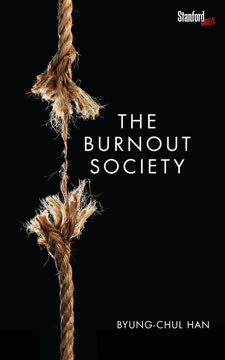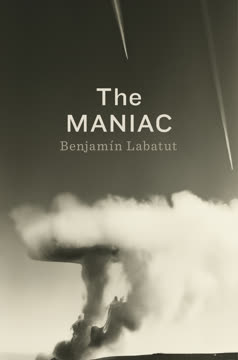Points clés
1. Les nouveaux médias naissent de la convergence de l’informatique et des médias.
Quelle est la synthèse de ces deux histoires ? La traduction de tous les médias existants en données numériques accessibles par les ordinateurs.
Une fusion historique. Les nouveaux médias ne sont pas une invention soudaine, mais le fruit de la convergence de deux trajectoires historiques distinctes : le développement des machines informatiques (à commencer par la machine analytique de Babbage dans les années 1830) et celui des technologies médiatiques modernes (comme le daguerréotype de Daguerre, de la même époque). Ces deux avancées étaient essentielles aux sociétés de masse modernes, permettant respectivement le traitement des données et la communication de masse.
Du calcul à la culture. Initialement séparés, ces chemins se rejoignent lorsque les médias sont traduits en données numériques, rendant leur traitement possible par ordinateur. L’ordinateur, d’abord simple calculateur, devient une machine médiatique universelle capable de traiter, stocker, distribuer et accéder à des textes, images, sons et constructions spatiales. Cette transformation est sans doute plus profonde que celles de l’imprimerie ou de la photographie, affectant toutes les étapes et formes de la communication médiatique.
Le métier Jacquard renaît. Le lien entre informatique et médias était présent dès l’origine, puisque Babbage s’est inspiré du métier à tisser Jacquard, une machine programmée pour tisser des images. Ce lien précoce annonçait le retour de l’ordinateur à ses racines, non plus comme simple moteur analytique des nombres, mais comme synthétiseur et manipulateur de médias, puissant outil de production et d’accès culturels.
2. Cinq principes fondamentaux définissent le langage des nouveaux médias.
Cette liste réduit tous les principes des nouveaux médias à cinq : représentation numérique, modularité, automatisation, variabilité et transcoding culturel.
La base de la calculabilité. La représentation numérique signifie que tous les nouveaux médias sont codés en chiffres, ce qui les rend mathématiquement décrivables et manipulables par algorithmes. Cela transforme les médias en données programmables, autorisant des processus automatisés comme la réduction du bruit ou l’amélioration d’image.
Blocs de construction et souplesse. La modularité, ou « structure fractale », signifie que les objets médiatiques sont composés d’éléments discrets (pixels, polygones) qui conservent leur identité lorsqu’ils sont assemblés en objets plus grands. Cela permet une modification aisée, une substitution et une organisation non linéaire, contrairement à la nature fixe des copies dans les médias traditionnels.
Efficacité et transformation. L’automatisation exploite le codage numérique et la modularité pour éliminer l’intention humaine de certaines parties du processus créatif, des filtres simples à la génération complexe de contenu par intelligence artificielle. La variabilité permet aux objets médiatiques d’exister en versions potentiellement infinies, personnalisées automatiquement selon les informations utilisateur ou d’autres paramètres, reflétant la logique post-industrielle de la personnalisation individuelle. Enfin, le transcoding décrit la conséquence la plus importante : l’influence de la logique organisationnelle de l’ordinateur (structures de données, algorithmes, interfaces) sur la couche culturelle des médias, mêlant sens humain et informatique.
3. Les interfaces des nouveaux médias mêlent traditions de l’imprimé, du cinéma et de l’interaction homme-machine.
En bref, nous n’interagissons plus avec un ordinateur, mais avec une culture codée numériquement.
La culture comme interface. À mesure que les ordinateurs deviennent des machines médiatiques universelles, nous interagissons de plus en plus avec des données culturelles (textes, images, films) via des interfaces. Ces « interfaces culturelles » ne sont pas neutres : elles façonnent notre perception et notre interaction avec la culture numérique, imposant leur propre logique et modèles du monde.
Un langage hybride. Les interfaces culturelles s’appuient largement sur des formes culturelles familières :
- Le mot imprimé : Des conventions comme la page rectangulaire, l’organisation séquentielle, la table des matières et l’index influencent la mise en page et la navigation (pages Web, CD-ROM). L’hyperlien, bien que paraissant nouveau, constitue une rupture radicale avec l’organisation traditionnelle du texte, favorisant la métonymie et la non-hiérarchie.
- Le cinéma : Les manières cinématographiques de voir, structurer le temps et raconter des histoires s’étendent aux utilisateurs d’ordinateurs. La caméra mobile devient une convention d’interface pour naviguer dans des données 3D, le cadrage rectangulaire persiste, et les techniques cinématographiques sont codées dans les logiciels et matériels.
- L’interface homme-machine (IHM) : Des principes comme la manipulation directe, les fenêtres, menus et icônes fournissent la grammaire de base de l’interaction, se mêlant aux conventions des médias plus anciens.
Naviguer entre logiques concurrentes. Les interfaces culturelles négocient souvent entre la richesse du contrôle dans l’IHM générale et l’expérience immersive des médias traditionnels. Cela crée des tensions, comme cacher les hyperliens dans des images continues (illusion vs contrôle) ou équilibrer standardisation (IHM) et originalité (art traditionnel). Le résultat est un langage hybride encore en gestation, reflet du processus en cours de la culture informatisée.
4. L’écran d’ordinateur évolue de la fenêtre statique au panneau de contrôle interactif.
Il s’agit du troisième type d’écran, après l’écran classique et l’écran dynamique : l’écran en temps réel.
Une longue histoire du cadrage. L’écran, surface plane et rectangulaire encadrant un monde virtuel, possède une histoire remontant à la peinture de la Renaissance (« écran classique »). Le cinéma a introduit « l’écran dynamique », affichant des images changeantes dans le temps, favorisant identification et immersion du spectateur.
Temps réel et interactivité. L’écran d’ordinateur inaugure une nouvelle étape : « l’écran en temps réel », capable de mises à jour continues reflétant des données changeantes. Surtout, il devient interactif, permettant à l’utilisateur de donner des commandes et d’agir directement sur la réalité via l’affichage. Ce changement trouve son origine dans la surveillance militaire (radar, système SAGE), où l’écran est passé d’un affichage passif à un panneau de contrôle actif.
Au-delà du cadre. Les interfaces modernes défient l’écran traditionnel de deux manières :
- Interface à fenêtres : Affiche plusieurs fenêtres coexistantes, rompant la domination d’une image unique et s’alignant davantage sur la mise en page graphique que sur l’écran cinématographique.
- Réalité virtuelle (RV) : Supprime complètement l’écran, immergeant l’utilisateur dans l’espace virtuel et nécessitant un déplacement physique pour naviguer, bien que souvent relié à une machine.
Du visionnage passif au contrôle actif. L’écran d’ordinateur incarne un changement fondamental, passant du régime de visionnage de l’ère de l’écran dynamique (identification, immersion) à celui d’interaction et de contrôle. Il fonctionne à la fois comme une fenêtre sur un espace illusionniste et comme un tableau de bord virtuel, reflet de ses origines dans les systèmes militaires de commandement et contrôle.
5. Les opérations des nouveaux médias reflètent et transforment les pratiques culturelles.
Elles ne sont pas seulement des manières de travailler avec des données informatiques, mais aussi des façons générales de travailler, de penser et d’exister à l’ère informatique.
Le logiciel comme filtre culturel. Au-delà de l’interface, les logiciels applicatifs offrent une couche d’opérations qui façonnent notre création et interaction avec les nouveaux médias. Ces opérations — copier, couper, coller, chercher, filtrer, composer — ne sont pas spécifiques à un média, mais s’appliquent à différents types de données, du fait du statut informatique des médias.
Les opérations comme logique culturelle. Ces opérations, intégrées dans les logiciels, s’étendent au monde social. Elles deviennent des stratégies cognitives et des modes d’existence à l’ère informatique. La communication est bidirectionnelle : la conception logicielle reflète une logique sociale, et l’usage des logiciels façonne notre compréhension de nous-mêmes et du monde.
Exemples d’opérations clés :
- Sélection : Choisir dans des menus ou bibliothèques pré-définis (modèles 3D, filtres, gabarits). Cela reflète un tournant culturel vers l’assemblage à partir de pièces prêtes à l’emploi, visible dans les modes de consommation modernes et l’art postmoderne fondé sur la citation et le pastiche.
- Composition : Assembler des éléments de sources diverses en un tout homogène. C’est central dans la création d’images et vidéos numériques, traduisant un désir de continuité, en contraste avec le montage moderniste.
- Téléaction : Agir à distance en temps réel via des représentations (téléprésence, télécommande). Cela prolonge des instruments-image anciens (cartes, radiographies) en ajoutant un retour instantané et une manipulation en temps réel, rendus possibles par les télécommunications électroniques.
Ces opérations, codées en algorithmes et matérialisées dans les logiciels, illustrent le principe de transcoding, où la logique informatique influence les pratiques culturelles et réciproquement.
6. La composition numérique transforme l’image animée du montage vers la continuité.
Le plus souvent, l’image animée construite par composition simule un plan de film traditionnel.
Assembler la réalité virtuelle. La composition numérique, qui combine plusieurs séquences d’images et images fixes en une seule, est une opération centrale dans la production des nouveaux médias, notamment pour l’image animée. Elle permet de construire des espaces virtuels 3D sans couture à partir d’éléments divers, simulant mouvements de caméra et artefacts médiatiques.
Au-delà du montage traditionnel. Alors que le montage (juxtaposition temporelle) était la technique clé du cinéma pour créer des réalités factices, la composition numérique (mélange spatial) offre une esthétique alternative de continuité. Les éléments sont fondus, les frontières effacées, créant une gestalt unique, à l’opposé de la dissonance voulue du montage.
Nouvelles dimensions du contrôle. La composition, surtout dans les interfaces logicielles, met en lumière de nouvelles dimensions spatiales de l’image animée, en plus du temps :
- Ordre spatial des couches (espace 2,5D).
- Espace virtuel construit (espace 3D).
- Mouvement des couches dans le cadre (espace 2D).
- Relation entre image et informations liées (espace 2D).
Cela déplace l’attention du montage temporel vers l’organisation et le mélange spatiaux. Souvent utilisée pour simuler photoréalistiquement, la composition peut aussi créer de nouvelles formes de « montage spatial », « montage ontologique » (coexistence d’éléments incompatibles) ou « montage stylistique » (juxtaposition de styles médiatiques différents), comme dans les œuvres de Rybczynski, Zeman et Tobreluts.
7. Le réalisme synthétique simule la vision photographique, non la perception humaine.
L’image synthétique générée par ordinateur n’est pas une représentation inférieure de notre réalité, mais une représentation réaliste d’une autre réalité.
Imiter la photographie. L’objectif principal de la recherche en infographie 3D a été le photoréalisme — créer des images indiscernables de photographies. Cela ne revient pas à simuler la perception humaine ou la réalité elle-même, mais à reproduire les artefacts et limites spécifiques de l’objectif photographique et du film (profondeur de champ, grain, gamme tonale).
Trop parfaite, trop réelle. Paradoxalement, les images synthétiques sont souvent « trop parfaites » avant d’être dégradées pour correspondre aux imperfections du film. Elles sont exemptes d’artefacts optiques et de bruit, possèdent une résolution et un détail illimités. Cette qualité hyperréaliste suggère qu’elles ne sont pas des représentations inférieures de notre réalité, mais des représentations réalistes d’une autre réalité — la vision d’un ordinateur, d’un cyborg, d’une grille numérique.
Messagères du futur. Contrairement aux photographies traditionnelles qui renvoient au passé, les images synthétiques pointent vers l’avenir. Elles dépeignent une réalité à venir, potentiellement réduite à la géométrie et à la représentation efficace. Des films comme Jurassic Park et Terminator 2 illustrent cela, les dinosaures masquant la vision future ou les cyborgs l’incarnant directement, souvent en dégradant l’image parfaite de l’ordinateur pour la mêler au film familier ou en utilisant sa netteté pour signifier un futur étranger.
Cette quête du photoréalisme, motivée par des besoins militaires et de divertissement, produit un réalisme inégal, excellent pour simuler certains phénomènes (paysages, figures) mais moins pour d’autres, reflétant les priorités de ses commanditaires et les icônes culturelles de la mimésis.
8. Base de données et récit s’opposent comme formes dominantes dans la culture informatique.
Ainsi, base de données et récit sont des ennemis naturels.
L’essor de la collection. À l’ère informatique, la base de données émerge comme une forme culturelle clé, défiant la domination du récit. Beaucoup d’objets des nouveaux médias sont des collections d’éléments sans début, fin ou séquence fixe, reflétant le monde comme un ensemble non structuré de données.
Le récit comme trajectoire dans la base. Si certains objets sont explicitement des bases de données (encyclopédies, sites Web), la plupart le sont implicitement. Créer un nouveau média implique souvent de construire une interface vers une base multimédia. Dans cette optique, un récit n’est qu’une trajectoire possible à travers une base, un ordre spécifique d’éléments parmi une collection plus vaste.
Privilégier le paradigme. Les nouveaux médias inversent la relation traditionnelle entre récit (syntagme) et ensemble sous-jacent de possibilités (paradigme). La base de données (paradigme) acquiert une existence matérielle et devient le centre du processus créatif, tandis que le récit (syntagme) se dématérialise en un ensemble de liens ou une trajectoire virtuelle. Les interfaces interactives mettent encore plus en avant le paradigme en proposant à l’utilisateur des menus explicites de choix.
Malgré la logique inhérente de la base de données, le désir de récit persiste, conduisant à des tentatives de fusionner base et récit en nouvelles formes, comme les récits interactifs ou films pilotés par base de données, explorant comment le récit peut se construire à partir de la structure sous-jacente.
9. L’espace navigable devient un type de média et une forme culturelle.
Pour la première fois, l’espace devient un type de média.
Traverser le virtuel. L’espace navigable, où l’utilisateur se déplace dans des environnements 3D simulés, est une forme clé des nouveaux médias, présente dans les jeux, mondes virtuels, simulateurs et visualisations de données. Il spatialise données et expérience, assimilant récit et temps au mouvement à travers pièces, niveaux ou paysages abstraits.
Au-delà de la représentation statique. Contrairement aux représentations traditionnelles de l’espace (cartes, peintures, architecture), l’espace informatique est navigable. Il peut être instantanément transmis, stocké, récupéré et manipulé comme d’autres types de médias. Cela en fait une représentation spatiale fondamentalement nouvelle.
Agrégat, non systématique. Malgré le système de coordonnées cartésiennes sous-jacent, les espaces informatiques sont souvent des collections agrégées d’objets plutôt que des environnements cohérents et continus. Des techniques comme la modélisation polygonale et la superposition de sprites sur fonds créent des mondes d’entités séparées, dépourvus de la qualité de « milieu spatial » que l’on trouve dans certaines peintures modernes ou animations traditionnelles. Cela reflète la modularité des données informatiques et peut-être des tendances culturelles à la fragmentation.
Du flâneur au cowboy des données. L’expérience de navigation dans l’espace virtuel se relie à des figures historiques comme le flâneur de Baudelaire et l’explorateur américain. Le flâneur virtuel parcourt des paysages de données, tandis que l’explorateur virtuel navigue dans des mondes de jeu, construisant son personnage par le mouvement spatial et l’exploration. Cette forme, issue des simulateurs militaires et étendue aux applications civiles, traduit un tournant culturel vers l’accès et l’interaction spatialisés des données.
10. Le cinéma numérique redéfinit le film comme une sous-catégorie de l’animation.
Le cinéma numérique est un cas particulier d’animation qui utilise des images tournées en prise de vue réelle comme l’un de ses nombreux éléments.
Crise de l’indexicalité. L’identité du cinéma traditionnel reposait sur sa capacité à enregistrer la réalité physique par la photographie optique — il était un art de l’index. La technologie numérique remet cela en cause en permettant de générer des scènes photoréalistes entièrement par ordinateur ou de manipuler largement les images après numérisation.
Retour à la construction manuelle. Le cinéma numérique s’appuie sur des techniques auparavant marginalisées et déléguées à l’animation :
- Générer des scènes directement en ordinateur (animation 3D).
- Traiter les images tournées comme matière brute à manipuler (peinture, traitement, composition).
- Construire manuellement les images finales à partir d’éléments divers.
- Effacer la distinction entre montage et effets spéciaux.
De l’œil-cinéma au pinceau-cinéma. Le processus cinématographique passe de l’enregistrement automatique de la réalité à la construction manuelle d’images, image par image si nécessaire. Les images tournées perdent leur statut privilégié et deviennent un élément parmi d’autres, aux côtés des graphismes générés par ordinateur. Le cinéma numérique est donc
Dernière mise à jour:
FAQ
What is The Language of New Media by Lev Manovich about?
- Comprehensive analysis of new media: The book explores the language, forms, and conventions of new media, situating them within the broader history of visual and media cultures.
- Interdisciplinary theoretical framework: Manovich draws from art history, media studies, computer science, and social theory to build a foundational theory of new media.
- Focus on technology and culture: It examines how computerization and digital technologies reshape cultural forms, especially through the lens of cinema and human-computer interaction.
Why should I read The Language of New Media by Lev Manovich?
- Foundational new media theory: The book offers a rigorous, systematic framework for understanding new media beyond surface-level trends like interactivity or hypermedia.
- Historical and cultural context: It situates new media within a long trajectory of visual and technological developments, helping readers anticipate future shifts.
- Practical and critical insights: Manovich provides both theoretical grids and practical perspectives for artists, designers, and anyone interested in digital culture.
What are the key takeaways from The Language of New Media by Lev Manovich?
- Five principles of new media: Numerical representation, modularity, automation, variability, and transcoding are central to understanding digital culture.
- Database and navigable space: These are the two dominant cultural forms in new media, shaping how information is organized and experienced.
- Cinema’s influence on new media: The book highlights how cinematic language and conventions are embedded in digital interfaces and aesthetics.
What are the five key principles of new media according to Lev Manovich in The Language of New Media?
- Numerical representation: All new media objects are digital, making them programmable and subject to algorithmic manipulation.
- Modularity: New media is built from discrete, independent modules that can be combined or modified separately.
- Automation: Digital coding and modularity enable automated creation and manipulation, from simple edits to AI-driven processes.
- Variability: New media objects can exist in infinite versions, customized or generated on demand, reflecting post-industrial logic.
- Transcoding: New media operates on both cultural and computer layers, blending human meanings with computational logic.
How does Lev Manovich define a "new media object" in The Language of New Media?
- Broad, inclusive definition: A new media object can be anything from a digital image or film to a website or virtual environment.
- Emphasis on modularity: These objects are constructed from independent elements, echoing object-oriented programming paradigms.
- Cultural and industrial implications: The term reflects the merging of art, design, and mass production, as well as experimental approaches from avant-garde traditions.
How does The Language of New Media by Lev Manovich describe the relationship between cinema and new media?
- Cinema as conceptual lens: The book uses cinema history and theory to analyze new media’s development and conventions.
- Cinematic language in interfaces: Cinematic ways of seeing, editing, and structuring time are embedded in digital interfaces and virtual worlds.
- Toolbox for new media: Cinema provides a set of perceptual and editing conventions that are encoded into software and hardware, shaping user experiences.
What does Lev Manovich mean by "cultural interfaces" in The Language of New Media?
- Human-computer-culture interface: Cultural interfaces are how computers present and allow interaction with cultural data—texts, images, films, music, and virtual spaces.
- Hybrid of old and new: They combine elements from cinema, print, and human-computer interfaces, creating a hybrid language for digital culture.
- Negotiation of traditions: Cultural interfaces balance immersive experiences with detailed user control, resulting in evolving forms of interaction.
What is the significance of the "database" form in The Language of New Media by Lev Manovich?
- Database as cultural logic: Databases organize information as collections without inherent narrative order, reflecting digital modularity and random access.
- Contrast with narrative: While narratives impose linear order, databases allow for multiple, non-linear paths through information.
- Database narratives: New media artists experiment with merging database and narrative, creating new aesthetic and storytelling possibilities.
How does Lev Manovich explain the concept of "navigable space" in The Language of New Media?
- Definition and importance: Navigable space refers to interactive 3D environments where users move through virtual worlds, central to games and VR.
- Historical roots: The concept draws on earlier cultural practices like urban exploration and flight simulation, showing deep anthropological origins.
- Aesthetic and experiential form: Navigable space is not just technical but shapes new ways of experiencing, visualizing, and designing information and environments.
What is the "logic of selection" in new media according to The Language of New Media by Lev Manovich?
- Selection over creation: New media often involves assembling works from pre-existing parts, rather than creating from scratch.
- Historical and cultural parallels: This logic echoes earlier practices like photomontage and electronic music, aligning with postmodern recycling and quotation.
- Implications for authorship: The creator becomes a selector and combiner, challenging traditional notions of originality and authorship.
How does The Language of New Media by Lev Manovich address the relationship between database and narrative?
- Opposition and interplay: Database and narrative are cultural opposites—unordered collections versus linear stories—but new media often merges them.
- Narrative as database trajectory: Interactive narratives can be seen as specific paths through a database, with the database as the material paradigm.
- Database dominance: The logic of the database underlies most new media, privileging modularity and multiple access over linear storytelling.
What are the implications of digital compositing and spatial montage in The Language of New Media by Lev Manovich?
- Digital compositing: Combines multiple image layers into seamless wholes, replacing montage’s discontinuities with smooth, modular assembly.
- Spatial montage: Presents multiple images simultaneously, reviving pre-cinematic narrative forms and paralleling modern multitasking interfaces.
- Aesthetic and cultural impact: These techniques enable new forms of visual storytelling, challenge traditional linearity, and reflect the distributed attention of digital culture.
Avis
The Language of New Media suscite des avis partagés, avec une note moyenne de 3,86 sur 5. Les lecteurs saluent l’originalité des idées de Manovich et ses liens historiques, mais reprochent son obsession pour le cinéma ainsi que des exemples parfois datés. Certains jugent l’ouvrage perspicace et fondamental pour les études sur les nouveaux médias, tandis que d’autres peinent à surmonter un style dense et répétitif. Les critiques soulignent son analyse prémonitoire de l’impact de la culture numérique, tout en regrettant un manque de profondeur concernant des enjeux contemporains tels que la distribution des médias. Malgré ses défauts, beaucoup considèrent ce livre comme un texte essentiel pour comprendre l’évolution des médias numériques.