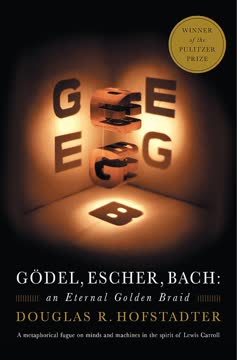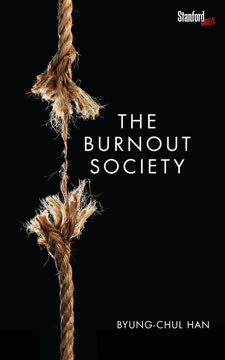Points clés
1. L’intelligence est la forme la plus élevée d’adaptation biologique, équilibrant assimilation et accommodation.
Définir l’intelligence en termes de réversibilité progressive des structures mobiles qu’elle forme revient donc à répéter, avec d’autres mots, que l’intelligence constitue l’état d’équilibre vers lequel tendent toutes les adaptations successives de nature sensori-motrice et cognitive, ainsi que toutes les interactions assimilatrices et accommodatrices entre l’organisme et l’environnement.
L’adaptation est essentielle. L’intelligence n’est pas une faculté isolée, mais la forme la plus avancée d’adaptation, un équilibre entre l’action de l’organisme sur l’environnement (assimilation) et l’action de l’environnement sur l’organisme (accommodation). L’assimilation consiste à intégrer la réalité dans des structures mentales existantes, ou « schèmes », tandis que l’accommodation modifie ces structures pour s’ajuster à une nouvelle réalité.
Continuité fonctionnelle. Cette conception adaptative place l’intelligence sur un continuum avec tous les processus biologiques et cognitifs, des réflexes élémentaires et de la perception jusqu’au raisonnement complexe. Elle représente l’état ultime d’équilibre de ces processus, caractérisé par sa plasticité et sa durabilité. L’intelligence permet d’interagir avec l’environnement à des distances croissantes dans l’espace et le temps, libérant l’action de l’immédiateté du « hic et nunc ».
Équilibre atteint. L’équilibre entre assimilation et accommodation devient de plus en plus mobile et stable à mesure que l’intelligence se développe. Cet équilibre dynamique, culminant dans des opérations réversibles, permet à l’individu de comprendre et d’interagir avec le monde de manière flexible et puissante, étendant les processus adaptatifs à une réalité plus large.
2. L’intelligence est fondamentalement opérationnelle, construite à partir d’actions intériorisées et réversibles formant des systèmes structurés appelés groupements.
La nature spécifique des opérations, par opposition aux actions empiriques, tient au fait qu’elles n’existent jamais à l’état discontinu.
Les opérations sont des actions. La pensée logique et mathématique ne consiste pas simplement à appréhender des idées externes, mais repose sur des « opérations », c’est-à-dire des actions intériorisées. Celles-ci ne sont pas des actes isolés, mais s’organisent en systèmes cohérents, contrairement aux actions empiriques simples ou aux représentations intuitives.
Les systèmes sont des groupements. Ces systèmes opérationnels sont appelés « groupements », caractérisés par des propriétés spécifiques :
- Combinativité : les opérations peuvent être combinées.
- Réversibilité : chaque opération possède une inverse qui peut l’annuler.
- Associativité : le chemin suivi pour aboutir à un résultat n’en modifie pas l’issue.
- Identité : une opération combinée à son inverse est annulée.
- Tautologie (pour les groupements qualitatifs) : répéter une opération ne change pas le résultat (A + A = A).
Une logique vivante. Les groupements représentent l’état d’équilibre de la pensée, assurant mobilité et permanence. Ils constituent la réalité psychologique sous-jacente à la logique formelle, laquelle est vue comme le modèle axiomatique de cet équilibre, et non comme une structure préexistante imposée à l’esprit.
3. La perception diffère de l’intelligence par sa nature irréversible et statistique, tandis que l’intelligence atteint une relativité objective grâce à des opérations mobiles et réversibles.
Une structure perceptive se caractérise, comme l’a souligné la théorie de la Gestalt, par son irréductibilité à une combinaison additive — elle est donc irréversible et non associative.
Les limites de la perception. Si la théorie de la Gestalt met en avant la nature « globale » des structures perceptives, celles-ci diffèrent fondamentalement des groupements opérationnels. La perception se caractérise par :
- L’irréversibilité : les changements perceptifs sont souvent non compensés.
- La non-additivité : le tout n’est pas la simple somme des parties.
- La non-associativité : la perception dépend du chemin suivi.
- Une relativité déformante : la perception accentue les différences (loi de Weber) et est sujette aux illusions.
Nature statistique. Les mécanismes perceptifs fonctionnent sur la base de probabilités et de distributions statistiques de l’attention ou des « centrations ». Cela engendre des « changements non compensés » et des « déplacements d’équilibre », à l’inverse des compensations exactes et de l’équilibre permanent de la pensée opératoire.
Objectivité opératoire. L’intelligence, par ses opérations mobiles et réversibles, atteint une autre forme de relativité — la relativité objective. En coordonnant plusieurs points de vue et en compensant les transformations, la pensée opératoire surmonte les distorsions inhérentes à la perception, conduisant à des concepts stables tels que la conservation.
4. L’habitude et l’intelligence sensori-motrice partagent des origines dans l’assimilation sensori-motrice, l’intelligence dépassant les réponses immédiates et rigides.
L’affinité entre habitude et intelligence devient ainsi manifeste, toutes deux émergeant, bien que sur des niveaux différents, de l’assimilation sensori-motrice.
Fondation commune. La formation des habitudes et les débuts de l’intelligence proviennent tous deux de l’assimilation sensori-motrice, processus d’intégration de nouvelles expériences dans des schèmes d’action existants. Même les réponses conditionnées simples impliquent l’intégration d’éléments nouveaux dans des schémas comportementaux préexistants, et non une simple association passive.
Au-delà de la rigidité. Si les habitudes se caractérisent par des réponses stéréotypées et unidirectionnelles à des circonstances récurrentes, l’intelligence apparaît lorsque cette activité assimilatrice dépasse ces liens immédiats et rigides. Elle implique :
- Une mobilité accrue : les schèmes deviennent plus flexibles et peuvent se combiner de nouvelles façons.
- Un champ d’action étendu : l’action anticipe et reconstruit des événements au-delà du présent immédiat.
- Une différenciation des moyens et des fins : les objectifs sont fixés avant l’application des moyens.
Continuité d’activité. Le tâtonnement expérimental, souvent considéré comme la base de l’habitude et de l’intelligence naissante, n’est pas purement aléatoire mais guidé par des schèmes et des significations existants. Cette accommodation active, agissant de concert avec l’assimilation, favorise le passage des habitudes simples à des comportements plus complexes et intelligents.
5. L’intelligence sensori-motrice se développe par étapes de schèmes d’action de plus en plus complexes, culminant dans la permanence pratique de l’objet et les groupes spatiaux.
L’intelligence précoce est donc simplement la forme d’équilibre mobile vers laquelle tendent les mécanismes adaptés à la perception et à l’habitude ; mais ces derniers n’y parviennent qu’en quittant leurs champs respectifs d’application.
Fondation préverbale. Avant le langage, l’intelligence se développe à travers six stades de coordination sensori-motrice. Partant des réflexes et habitudes primaires, le nourrisson progresse par :
- Les réactions circulaires primaires (répétition centrée sur le corps)
- Les réactions circulaires secondaires (action sur des objets externes)
- La coordination des schèmes secondaires (comportement moyen-fin)
- Les réactions circulaires tertiaires (expérimentation active)
- L’invention par combinaison mentale (action intériorisée)
Construction de l’objet et de l’espace. Ce développement est intrinsèquement lié à la construction de concepts fondamentaux tels que l’objet permanent et les relations spatiales. La permanence de l’objet, c’est-à-dire la compréhension que les objets existent même lorsqu’ils ne sont pas perçus, émerge progressivement par la coordination des schèmes sensori-moteurs, notamment ceux impliquant la recherche et le déplacement.
Groupe pratique. À la fin de cette période (vers 1,5 à 2 ans), l’enfant construit un « groupe de déplacements » pratique. Il s’agit d’une compréhension empirique des transformations spatiales (mouvements, inversions, détours) et de la conservation de la position, obtenue par la coordination d’actions physiques, non par la pensée conceptuelle.
6. La pensée se développe à travers des stades préopératoires (symbolique, préconceptuel, intuitif) marqués par l’égocentrisme, le phénoménalisme et des expériences mentales irréversibles.
La pensée intuitive manifeste donc toujours un égocentrisme déformant, puisque la relation reconnue est liée à l’action du sujet et non décentralisée dans un système objectif.
Fonction symbolique. La transition de l’intelligence sensori-motrice à la pensée est marquée par l’émergence de la fonction symbolique (vers 1,5-2 ans), permettant la représentation par des signifiants distincts (symboles, signes). Cela inclut l’imitation différée, le jeu symbolique, l’imagerie mentale et l’acquisition du langage.
Pensée préconceptuelle. Le premier stade (environ 2-4 ans) utilise des « préconcepts », notions intermédiaires entre les cas particuliers et les classes générales. Le raisonnement est « transductif », passant du particulier au particulier sur la base d’analogies immédiates ou d’actions imaginées, sans structure logique ni réversibilité.
Pensée intuitive. Le stade suivant (environ 4-7 ans) est « intuitif », caractérisé par des représentations mentales étroitement liées aux configurations perceptives. La pensée reste :
- Égocentrique : centrée sur le point de vue du sujet, incapable de coordonner les perspectives.
- Phénoménaliste : focalisée sur l’apparence immédiate plutôt que sur la réalité sous-jacente.
- Irréversible : les transformations mentales sont unidirectionnelles.
Régulations, non opérations. La pensée intuitive progresse par « intuition articulée », où des régulations (analogues aux ajustements perceptifs) corrigent les distorsions et conduisent à des représentations plus justes. Cependant, il ne s’agit pas encore d’opérations pleinement réversibles ni dotées de la structure combinatoire de la vraie logique.
7. La pensée opératoire concrète émerge avec la formation de groupements réversibles, permettant la conservation et le raisonnement logique lié aux objets manipulables.
là où il y a « groupement », il y aura conservation d’un tout, et cette conservation ne sera pas simplement supposée par le sujet par induction probable, mais affirmée par lui comme une certitude dans sa pensée.
Le tournant opératoire. Vers 7-8 ans, un changement majeur survient : les régulations intuitives se regroupent en opérations réversibles, formant des « groupements concrets ». Cette transition est souvent rapide et marquée par la certitude de l’enfant quant à la conservation.
La conservation comme marqueur. L’indicateur clé de la pensée opératoire est la compréhension de la conservation — qu’une quantité reste identique malgré les changements d’apparence. Cela concerne :
- La substance (vers 7-8 ans)
- Le poids (vers 9-10 ans)
- Le volume (vers 11-12 ans)
Logique concrète. Ces opérations sont « concrètes » car liées à des objets manipulables ou directement perceptibles. Elles permettent un raisonnement logique sur les classes (classification), les relations (sériation) et les nombres, ainsi que sur des concepts spatio-temporels comme la mesure et le temps. Toutefois, cette logique n’est pas encore généralisée et peut s’appliquer à un type de contenu avant un autre.
8. La pensée formelle, apparaissant à l’adolescence, consiste à opérer sur les opérations, permettant un raisonnement hypothético-déductif indépendant de la réalité concrète.
La pensée formelle, en revanche, consiste à réfléchir (au vrai sens du terme) sur ces opérations et donc à opérer sur les opérations ou leurs résultats, effectuant ainsi un groupement de second degré.
Penser la pensée. À partir de 11-12 ans environ, l’adolescent développe la capacité des « opérations formelles ». Cela implique de penser non seulement aux objets concrets et à leurs transformations, mais aux opérations elles-mêmes. C’est un niveau de pensée de « second degré ».
Raisonnement hypothético-déductif. La pensée formelle permet :
- Le raisonnement à partir d’hypothèses : envisager des possibilités qui ne sont pas nécessairement réelles.
- La déduction formelle : tirer des conclusions fondées sur la structure logique des arguments, indépendamment du contenu.
- La manipulation des propositions : raisonner sur les énoncés et leurs relations logiques (implication, contradiction).
Abstrait et général. Ce stade marque la capacité à raisonner de manière abstraite et à explorer systématiquement toutes les solutions possibles à un problème. Il fonde la pensée scientifique et philosophique, étendant l’intelligence au domaine du possible au-delà du réel immédiat.
9. Le développement intellectuel est une hiérarchie de constructions successives, où chaque niveau coordonne et différencie les structures du précédent.
Chacune des transitions d’un niveau à l’autre se caractérise donc à la fois par une nouvelle coordination et par une différenciation des systèmes constituant l’unité du niveau précédent.
Les fondations. Le développement n’est pas une accumulation lisse et continue, mais une série de stades distincts, chacun s’appuyant sur le précédent tout en le transformant. Les structures de niveau supérieur sont de nouvelles coordinations d’éléments de niveau inférieur.
Différenciation. Parallèlement à la coordination, le développement implique une différenciation. Initialement, diverses fonctions (logique, spatiale, pratique) sont indifférenciées dans les schèmes sensori-moteurs. Au fil du temps, ces fonctions se différencient en systèmes opérationnels distincts (par exemple, groupements logiques versus groupements spatio-temporels).
Équilibre progressif. Chaque stade représente une forme d’équilibre plus stable et mobile que le précédent. L’intelligence sensori-motrice atteint un équilibre pratique, la pensée intuitive est instable, les opérations concrètes assurent un équilibre stable pour les problèmes concrets, et les opérations formelles établissent un équilibre général pour les problèmes abstraits.
10. L’interaction sociale, en particulier la coopération, est cruciale pour le développement de la logique en favorisant la coordination et la décentration des points de vue.
La coopération est la première d’une série de formes de comportement importantes pour la constitution et le développement de la logique.
Influence sociale. La société influence profondément l’intelligence par le langage (signes), les connaissances partagées (valeurs) et les normes collectives (logique). Cependant, la nature de cette influence évolue selon le stade de développement de l’enfant.
Égocentrisme préopératoire. Durant la période préopératoire, l’égocentrisme de l’enfant (incapacité à différencier son point de vue de celui des autres) le rend sensible à la suggestion et à la contrainte externes, mais entrave le véritable échange intellectuel. Il assimile les apports sociaux à sa propre perspective sans les coordonner pleinement avec celles des autres.
Coopération opératoire. L’émergence de la pensée opératoire (concrète et formelle) est étroitement liée au développement de la coopération. Celle-ci implique :
- La réciprocité : compréhension mutuelle et respect des points de vue différents.
- La coordination : intégration de perspectives diverses en un tout cohérent.
- La décentration : dépassement de son propre point de vue pour considérer objectivement celui des autres.
La logique comme norme sociale. La logique elle-même, avec ses règles de cohérence et de déduction, peut être vue comme le résultat intériorisé de l’échange intellectuel coopératif. Le besoin de vérification et de démonstration découle du contrôle mutuel inhérent à la discussion et à la collaboration, faisant de la logique une « morale de la pensée » sanctionnée par le collectif.
Dernière mise à jour:
Avis
La psychologie de l’intelligence suscite des avis partagés, bien que nombreux soient ceux qui saluent son importance pour comprendre le développement cognitif. Les lecteurs apprécient les théories novatrices de Piaget sur l’évolution de l’intelligence, de la petite enfance à l’adolescence. Toutefois, certains trouvent l’ouvrage ardu en raison de son langage académique et de la complexité de ses concepts. Plusieurs critiques soulignent qu’il s’agit d’une lecture incontournable pour les professionnels de la psychologie ou de l’éducation, tandis que d’autres peinent à en saisir la densité. Malgré ces difficultés, beaucoup reconnaissent la valeur des éclairages de Piaget sur les processus cognitifs, l’adaptation et les stades du développement.
Similar Books