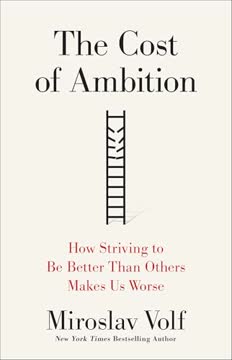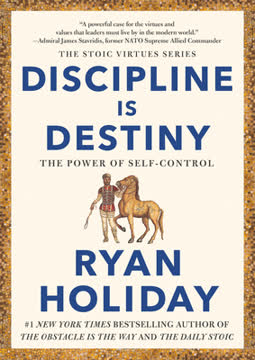Points clés
1. La quête de supériorité : une force omniprésente et destructrice
Un sentiment d’infériorité alimente la quête de supériorité, laquelle est toujours teintée à la fois d’orgueil et d’infériorité.
Un moteur universel. Le désir d’être meilleur que les autres est une tendance profondément ancrée dans la nature humaine, visible depuis les empereurs antiques comme Justinien, qui se vantait d’avoir surpassé Salomon en construisant Sainte-Sophie, jusqu’aux comparaisons quotidiennes autour des voitures ou des « likes » sur les réseaux sociaux. Cette quête se distingue de la recherche d’excellence, centrée sur l’amélioration de soi, car la supériorité implique souvent de rabaisser autrui ou d’entraver son succès. L’ouvrage souligne que si la quête de supériorité peut apporter des bénéfices instrumentaux (comme la renommée de Lionel Messi), sa valeur morale reste très discutable.
Un fléau social. Cette recherche omniprésente de supériorité s’immisce dans presque tous les domaines de la vie moderne, du sport à l’éducation, en passant par la politique et les réseaux sociaux. Elle engendre une pression incessante à se mesurer aux autres, provoquant des troubles psychiques généralisés tels que la dépression, qualifiée par l’auteur de « maladie de l’inadéquation ». La comparaison constante, surtout sur des plateformes soigneusement sélectionnées, favorise l’insatisfaction corporelle, les troubles alimentaires et une chute du sentiment de valeur personnelle, particulièrement chez les adolescents.
Une érosion des valeurs. Lorsque la supériorité devient la valeur dominante, elle peut dégrader les biens mêmes qu’elle prétend atteindre. Par exemple, la compétition acharnée pour accéder aux établissements d’élite déplace l’attention de l’apprentissage en soi vers la simple acquisition de statut, comme en témoignent les scandales d’admission et la corrélation entre richesse et accès aux écoles sélectives. De même, en politique, la quête de domination peut éclipser le bien commun, menant à une « décadence de la vérité » où les dirigeants privilégient la victoire électorale au détriment du discours factuel, encourageant la malhonnêteté.
2. Le « souci de la comparaison » empoisonne l’estime de soi
Fuir l’infériorité en cherchant la supériorité la tue.
La plainte du lys. Søren Kierkegaard illustre le danger de la comparaison par la parabole d’un lys des champs satisfait. Lorsqu’un « oiseau espiègle » lui apprend qu’ailleurs poussent des lys plus « magnifiques », le petit lys est envahi par le « souci de la comparaison », aspirant à devenir une « Impériale couronnée » enviée de tous. Cette quête agitée, née d’un sentiment d’infériorité, le conduit finalement à dépérir et mourir dans sa vaine recherche de validation extérieure.
Une atteinte à l’humanité. Kierkegaard affirme que cette « mentalité agitée de comparaison » est une « souillure corruptrice » qui abîme l’âme. Elle engendre :
- Une inquiétude constante : Qu’on soit haut ou bas sur l’échelle comparative, l’individu est rongé par l’angoisse — comment s’élever ou éviter d’être dépassé.
- Une érosion de l’unicité : Les comparaisons compétitives aplanissent les particularités individuelles, réduisant les personnes à leur succès ou échec sur une échelle souvent arbitraire.
- Une perte de soi : L’individu se disperse, attendant sans cesse une validation extérieure pour définir « ce qu’il est à cet instant », menant à une identité fragile et instable.
Une grandeur fictive. Pour Kierkegaard, la « grandeur » ou supériorité que l’homme cherche est une fiction. Si les qualités poursuivies (beauté, intelligence) sont réelles, le sentiment de supériorité qui en découle est illusoire et déshumanisant. Il soutient que notre « simple humanité » est une gloire incomparablement plus grande que toute distinction mondaine, et que poursuivre une grandeur extérieure au détriment de celle-ci est une forme de « désespoir » spirituel, une trahison de soi menant à une existence fantomatique.
3. L’ambition de Satan : la futilité de la supériorité ultime
Jusqu’à ce que l’orgueil et une ambition pire me précipitèrent, En guerre au Ciel contre le Roi incomparable du Ciel.
La rébellion contre la condition de créature. Dans Le Paradis perdu de John Milton, la quête de supériorité de Satan est le moteur cosmique du mal. Premier archange, grand en puissance, Satan ne supporte pas d’avoir un supérieur, voyant l’élévation du Fils par Dieu comme une « injustice méritée ». Sa révolte ne vise pas l’injustice, mais son infériorité ontologique en tant que créature. Pour justifier sa grande insurrection, Satan invente une fausse idéologie d’auto-création angélique, montrant comment la quête de supériorité nécessite souvent de déformer la réalité.
Le tourment de la haine de soi. Le monologue de Satan révèle une vérité douloureuse : sa guerre contre Dieu fut un « mal rendu pour un bien reçu », alimenté par un « espoir sans bornes » d’être « le plus haut ». Son incapacité à se repentir vient de la honte insupportable d’admettre son infériorité, entraînant un cycle d’auto-haine même s’il est « adoré » sur le trône de l’Enfer. Cette « misère » est la « joie que trouve l’ambition », illustrant comment une quête frustrée de supériorité peut se transformer en volonté de diminuer les concurrents en détruisant ce qu’ils chérissent, quitte à s’autodétruire.
L’ambition compromise d’Ève. La chute d’Ève repose aussi sur un désir de supériorité, quoique plus limité. Satan exploite son malaise face à la supériorité intellectuelle d’Adam, la flattant comme « maîtresse souveraine » et « dame universelle ». Après avoir mangé le fruit défendu, Ève espère « garder le pouvoir du savoir » et devenir « quelquefois supérieure » à Adam, croyant que « qui est inférieur est-il libre ? » Sa décision de partager le fruit avec Adam n’est pas motivée par l’amour, mais par la peur d’une infériorité ultime si elle devait mourir tandis qu’il vivrait avec une autre Ève.
4. La vraie gloire réside dans le service humble, non dans la quête de statut
C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
La descente de Christ. L’apôtre Paul présente Jésus-Christ comme l’exemple ultime opposé à la quête de supériorité. Dans le Carmen Christi (Philippiens 2:6-11), Christ, bien qu’existant « en forme de Dieu » et égal à Dieu, « ne regarda pas comme une proie à arracher l’égalité avec Dieu ». Au contraire, il « s’est vidé lui-même », prenant « la forme d’un serviteur » et s’humiliant jusqu’à la mort sur une croix — le summum du « cursus pudorum », la course aux humiliations. Cette abaissement radical n’était pas un moyen d’acquérir un statut, mais l’essence même de sa gloire divine.
La gloire dans le don de soi. L’exaltation de Christ par Dieu n’est pas une récompense pour sa souffrance, mais une justification publique que cet amour donné est la gloire. La gloire du Christ ne consiste pas à maintenir une eminence divine ou à dominer les autres, mais à les servir, même les plus méprisés, jusqu’à la mort honteuse. Cela montre ce que signifie être le « Très-Haut » face à la fragilité et aux besoins des créatures.
Un nouveau critère de valeur. Paul exhorte les chrétiens à adopter cet « esprit du Christ », à « ne rien faire par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais avec humilité considérer les autres comme supérieurs à vous-mêmes » (Philippiens 2:3). Cela implique de veiller activement aux intérêts d’autrui, les traitant comme s’ils avaient une place et une importance supérieures, indépendamment de leur mérite. Cet honneur mutuel, fondé sur l’exemple du Christ, déstabilise les hiérarchies mondaines et favorise une communauté de soin inconditionnel et d’honneur partagé.
5. Toute valeur humaine est un don, excluant toute raison de se vanter
Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? Et si tu l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l’avais pas reçu ?
L’illusion de l’autosuffisance. Paul remet en cause le fondement même de la vantardise et de la quête de supériorité en demandant : « Qui te distingue d’un autre ? Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » (1 Corinthiens 4:7). Sa réponse est implicite : rien. Chaque aspect de l’être humain — existence, capacités, réalisations, et même justice devant Dieu — est un don. Ainsi, toute prétention à s’être hissé à un statut supérieur par soi-même est une « falsification existentielle », un mensonge qui sous-tend la « sagesse » d’un monde voué à la perdition.
Se glorifier seulement dans le Seigneur. Paul, jadis ardent chercheur de supériorité religieuse, considère désormais ses anciens « acquis » (lignée, perfection selon la loi) comme des « pertes » ou des « déchets » après sa rencontre avec Christ. Sa nouvelle identité n’est « pas une justice qui vient de moi… mais celle qui vient par la foi en Christ » (Philippiens 3:9). Cette « justice étrangère » est un don de Dieu, excluant toute vantardise personnelle. La seule gloire légitime est « dans le Seigneur » (1 Corinthiens 1:31), reconnaissant en Christ la source unique de sagesse, puissance et dignité, mettant fin à toute revendication de supériorité individuelle.
Une récompense mutuelle. Paul redéfinit la notion de « récompense » en éliminant la compétition. Lorsqu’il parle de sa « couronne de gloire », ce n’est pas un prix individuel pour ses efforts, mais les personnes qu’il a servies : « N’est-ce pas vous ? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie ! » (1 Thessaloniciens 2:19-20). Cette joie partagée signifie que tous ceux qui embrassent la voie du Christ sont la récompense les uns des autres, et ensemble, ils forment la couronne du Christ. Ce système de récompense commun et non exclusif rend absurde la quête de supériorité individuelle.
6. La « folie » de Dieu redéfinit puissance et sagesse
La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes.
Un défi aux normes mondaines. Paul s’adresse à l’Église de Corinthe, influencée par des « super-apôtres » qui préféraient des leaders éloquents et puissants, et une « théologie de la gloire » à son « message de la croix ». Pour eux, le Christ crucifié semblait folie et faiblesse. Paul affirme que cette apparente « folie » et « faiblesse » de Dieu est en réalité « plus sage que la sagesse humaine » et « plus forte que la force humaine » (1 Corinthiens 1:25). Ce n’est pas une revendication compétitive, mais la déclaration d’une réalité immuable : la nature éphémère du pouvoir humain face à la vérité durable de l’amour donné de Dieu.
La logique renversée de Dieu. La méthode divine de rédemption est de « choisir ce qui est fou dans le monde pour confondre les sages ; Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour confondre les forts ; Dieu a choisi ce qui est bas et méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, pour abolir ce qui est » (1 Corinthiens 1:27-28). Cette stratégie divine vise à démanteler la « structure de la vantardise » afin que « personne ne puisse se glorifier devant Dieu ». Il ne s’agit pas seulement de renverser les rôles (faire du faible un fort), mais d’abolir les critères mêmes de la supériorité, créant une communauté où tous ont une égale dignité.
Le paradoxe de la vantardise. Dans sa seconde lettre aux Corinthiens, Paul, confronté à une opposition intense, se livre ironiquement à la « vantardise » pour dévoiler la folie des valeurs de ses adversaires. Il se vante non pas de ses forces, mais de ses faiblesses — souffrances, persécutions, dangers — qui, du point de vue du monde, font de lui un « apôtre inférieur ». Ce « discours de fou » (2 Corinthiens 11:16-12:10) montre que même une « vantardise renversée » reste une « vantardise charnelle », car toute vantardise repose sur une réussite personnelle pour affirmer sa supériorité. Le propos ultime de Paul est que toute gloire, même dans un service admirable, est problématique car la véritable action appartient au Christ qui vit en lui.
7. Les récits bibliques critiquent systématiquement la quête de prééminence
Celui qui veut être le premier doit être le dernier de tous et le serviteur de tous.
L’inversion radicale de Jésus. Jésus remet constamment en cause la recherche de statut. Lorsque Jacques et Jean demandent hardiment les premières places dans son royaume à venir, Jésus réprimande leur « lutte pour la première place ». Il déclare que « celui qui veut devenir grand parmi vous doit être votre serviteur, et celui qui veut être le premier doit être l’esclave de tous » (Marc 10:43-44). Il ne s’agit pas de renverser la hiérarchie (faire de l’infériorité la nouvelle supériorité), mais de rendre la supériorité elle-même une « non-valeur ». Le service est la fin, non un moyen pour s’élever au-dessus des autres.
Des précédents dans l’Ancien Testament. La critique de la quête de supériorité est profondément ancrée dans la Bible hébraïque :
- Caïn et Abel : Le meurtre d’Abel par Caïn est motivé par le désir de rétablir sa supériorité perçue après que Dieu ait préféré l’offrande d’Abel.
- L’appel d’Abraham : Le choix d’Abram par Dieu (Genèse 12:1-3) est présenté comme une grâce imméritée, non fondée sur une qualité ou un mérite, excluant toute revendication de supériorité.
- L’élection d’Israël : Deutéronome 7:6-8 affirme explicitement qu’Israël a été choisi non pour sa grandeur ou autre attribut, mais « parce que l’Éternel vous aime ». Cette élection imméritée rend « impossible pour l’auditeur attentif d’identifier l’élection à la supériorité ».
- La création d’Adam : Les sages rabbiniques interprètent la création solitaire d’Adam (Genèse 1) comme un moyen d’empêcher les générations futures de se vanter : « Mon père… est plus grand que ton père », soulignant l’origine commune et la dignité égale de toute l’humanité.
Les ambitieux imparfaits. Même des figures fondatrices comme Jacob et Joseph sont dépeintes comme des ambitieux acharnés. Jacob négocie impitoyablement le droit d’aînesse d’Ésaü et trompe son père pour obtenir la bénédiction. Joseph, jeune narcissique, exhibe son statut favori, ce qui conduit à son esclavage. Bien qu’ils connaissent tous deux des transformations ultérieures, reconnaissant la main de Dieu dans leur vie, leurs actions initiales illustrent la nature destructrice de leur ambition.
8. La providence divine agit à travers les failles, sans les justifier
Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l’a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux.
Les lignes courbes de Dieu. Le récit biblique, notamment dans la Genèse, montre la providence divine à l’œuvre même à travers les échecs moraux humains. Les paroles de Joseph à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l’a changé en bien » (Genèse 50:20), résument ce thème. Dieu utilise l’acte cruel des frères vendant Joseph en esclavage pour préserver la descendance de Jacob lors d’une famine. De même, Dieu agit à travers la ruse de Jacob pour faire de lui le père d’Israël.
Pas une « main invisible ». Cette providence divine ne ressemble pas à la « main invisible » d’Adam Smith, qui transforme les vices privés en biens publics, justifiant ou valorisant ainsi l’intérêt personnel et la quête de supériorité. La Bible ne maquille ni n’excuse les fautes morales de ses personnages. Elle condamne l’impudence de Jacob et le narcissisme de Joseph, tout en reconnaissant que les desseins divins ont été accomplis malgré ces actions imparfaites.
Condamnation sans justification. Le texte insiste sur le fait que Dieu « sait écrire droit avec des lignes courbes », c’est-à-dire qu’il peut tirer du bien du péché humain, mais cela ne « redresse » ni ne justifie la déviation morale elle
Dernière mise à jour:
Avis
« Le Prix de l’Ambition » recueille des éloges unanimes de la part des lecteurs, avec une note moyenne de 4,36 sur 5. Ceux-ci saluent le style d’écriture accessible de Volf ainsi que son analyse approfondie des effets néfastes de la quête de supériorité sur la foi chrétienne et la vie personnelle. L’ouvrage s’appuie sur les réflexions de Kierkegaard, Milton et l’apôtre Paul pour mettre en lumière les écueils moraux liés à l’ambition. Les lecteurs ont trouvé ce livre stimulant, convaincant et particulièrement pertinent dans le contexte contemporain, marqué par le capitalisme occidental et la culture numérique.