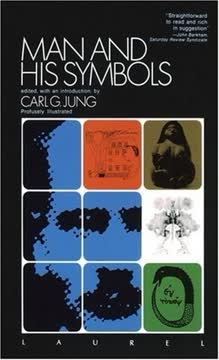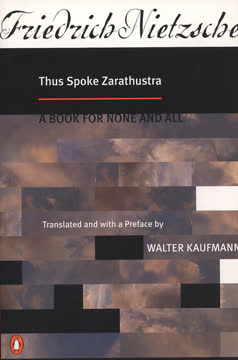Points clés
1. L’intelligence sensori-motrice construit une réalité fondée sur l’action
En l’absence de langage ou de fonction symbolique, ces constructions s’appuient uniquement sur les perceptions et les mouvements, par une coordination sensori-motrice des actions, sans intervention de la représentation ou de la pensée.
Les premiers schèmes d’action. De la naissance à environ deux ans, le nourrisson développe son intelligence à travers ses actions et ses expériences sensorielles. Cette période sensori-motrice se déploie en six stades, allant des réflexes simples à des schèmes d’action complexes, tels que la coordination des moyens et des fins pour résoudre des problèmes pratiques. Cette intelligence est essentiellement pratique, centrée sur la manipulation de l’environnement afin d’atteindre des objectifs.
La construction de la réalité. Durant cette phase, le nourrisson édifie des sous-structures cognitives fondamentales en organisant la réalité par l’action. Parmi les acquis majeurs figurent :
- La permanence de l’objet : la compréhension que les objets continuent d’exister même lorsqu’ils ne sont plus visibles.
- L’espace et le temps : l’organisation des mouvements et des perceptions dans un cadre spatio-temporel cohérent.
- La causalité : le développement d’une compréhension pratique des relations de cause à effet par la manipulation des objets.
La révolution copernicienne. Ce stade marque un tournant essentiel, passant d’un état initial d’égocentrisme, où le nourrisson ne distingue pas le soi du monde, à une perspective décentrée. L’enfant commence à se percevoir comme un objet parmi d’autres dans un univers structuré par des objets permanents, des relations spatiales et une causalité objective, posant ainsi les bases de la pensée ultérieure.
2. La perception soutient, mais ne crée pas, les structures logiques
Il importe donc de déterminer les rôles respectifs des perceptions et des actions (puis des opérations) dans le développement intellectuel de l’enfant.
Les limites de la perception. Si la perception fournit les données brutes de la réalité, elle n’est pas à l’origine des structures logiques ni de l’intelligence. La perception est essentiellement figurative, capturant des états statiques, tandis que l’intelligence est opératoire, traitant des transformations et des relations. Les études montrent que les constances perceptives (comme la constance de la taille ou de la forme) apparaissent avant les conservations opératoires, mais elles fonctionnent différemment.
Effets de champ versus activités. Le développement perceptif comprend deux aspects : les effets de champ (impressions immédiates, statiques, sujettes aux illusions) et les activités perceptives (exploration active, comparaison, anticipation). Ces activités s’améliorent avec l’âge et peuvent corriger certains effets de champ, mais elles sont souvent guidées par l’intelligence en développement plutôt que de la provoquer. Par exemple, les stratégies d’exploration des enfants deviennent plus systématiques à mesure que leurs capacités cognitives progressent.
Les concepts dépassent la perception. Les concepts ne sont pas de simples abstractions issues de la perception. Les concepts logico-mathématiques, par exemple, sont abstraits des actions effectuées sur les objets, et non des objets eux-mêmes. Même les concepts physiques requièrent une structure logico-mathématique que la perception seule ne peut fournir, démontrant que l’intelligence, enracinée dans l’action, organise la manière dont nous interprétons les données perceptives.
3. La fonction sémiotique libère la représentation mentale
Elle consiste en la capacité de représenter quelque chose (un signifié : objet, événement, schéma conceptuel, etc.) au moyen d’un « signifiant » différencié, qui ne sert qu’à une fonction représentative : langage, image mentale, geste symbolique, etc.
Transition vers la représentation. Vers 1,5 à 2 ans, la fonction sémiotique (ou symbolique) émerge, permettant à l’enfant d’évoquer des objets ou des événements absents. Ce changement fondamental rompt avec l’intelligence sensori-motrice, liée à l’action et à la perception immédiates. Cette fonction offre à la pensée un champ d’action considérablement élargi, au-delà de l’ici et maintenant.
Formes de la fonction sémiotique. L’apparition de cette fonction se manifeste par plusieurs comportements nouveaux qui surgissent presque simultanément :
- L’imitation différée : reproduire un modèle après sa disparition.
- Le jeu symbolique : utiliser des objets ou des actions pour représenter autre chose (par exemple, faire semblant qu’un cube est un téléphone).
- Le dessin : créer des représentations graphiques de la réalité.
- Les images mentales : imitations intériorisées servant de représentations internes.
- Le langage : usage de signes arbitraires (mots) pour désigner objets, événements et concepts.
Le rôle de l’imitation. L’imitation joue un rôle crucial dans cette transition, servant de pont entre l’action sensori-motrice et la représentation mentale. Initialement, l’imitation est une action directe, mais l’imitation différée et intériorisée (images mentales) devient un signifiant différencié, libérant la représentation des contraintes perceptives immédiates et ouvrant la voie à la pensée.
4. La pensée préopératoire assimile la réalité au moi
En général, la différence fondamentale entre les niveaux préopératoire et opératoire est qu’au niveau préopératoire prévaut l’assimilation à l’action propre de l’enfant, tandis qu’au niveau opératoire domine l’assimilation aux coordinations générales de l’action, donc aux opérations.
Perspective égocentrique. De 2 à 7 ans environ, la pensée se caractérise par l’égocentrisme, non pas au sens moral, mais comme difficulté à adopter un point de vue autre que le sien. L’enfant peine à différencier les points de vue subjectifs de la réalité objective, ce qui engendre des modes de compréhension du monde et d’interaction sociale singuliers.
Limites du raisonnement. La pensée préopératoire se concentre sur des configurations statiques plutôt que sur des transformations et manque de véritable réversibilité. Cela se manifeste par :
- La non-conservation : croire que la quantité change lorsque l’apparence change (par exemple, un liquide versé dans un verre plus haut est perçu comme plus abondant).
- La précausalité : expliquer les phénomènes par le finalisme, l’animisme ou l’artificialisme, assimilant souvent les processus physiques à ses propres actions ou désirs.
- Les collections figurales : classer les objets selon des critères perceptifs plutôt que selon l’inclusion logique des classes.
La prédominance du jeu symbolique. Le jeu symbolique est une caractéristique majeure de ce stade, permettant à l’enfant d’assimiler la réalité à ses propres besoins et désirs sans contraintes extérieures. Bien que crucial pour le développement affectif et symbolique, ce mode d’assimilation domine en contraste avec l’équilibre ultérieur entre assimilation et accommodation propre à la pensée opératoire.
5. Les opérations concrètes organisent logiquement le monde à travers les objets
Les opérations impliquées dans ces problèmes sont dites « concrètes » car elles se rapportent directement aux objets et non encore à des hypothèses formulées verbalement, comme c’est le cas des opérations propositionnelles que nous étudierons au chapitre 5.
L’émergence de la logique. Vers 7 à 11 ans, l’enfant développe les « opérations concrètes », actions intériorisées réversibles et organisées en systèmes cohérents ou « groupements ». Ces opérations permettent un raisonnement logique, mais restent liées aux objets et événements concrets, non aux propositions abstraites. L’acquisition de la conservation est l’indicateur psychologique clé de ce stade.
Principales opérations concrètes : L’enfant maîtrise diverses structures logiques :
- La conservation : comprendre que les propriétés (substance, poids, volume) restent invariantes malgré les changements d’apparence, justifié par l’identité, la réversibilité ou la compensation.
- La classification : organiser les objets en classes hiérarchiques et comprendre l’inclusion des classes (par exemple, toutes les roses sont des fleurs, mais toutes les fleurs ne sont pas des roses).
- La sériation : ordonner les objets selon une dimension quantitative (par exemple, la longueur ou le poids).
- Le nombre : construire le concept de nombre comme synthèse de l’inclusion de classes et de la sériation, conduisant à la conservation du nombre.
Le décentrement et la coordination. Ce stade implique un décentrement cognitif important, permettant à l’enfant de coordonner simultanément différentes dimensions ou perspectives (par exemple, hauteur et largeur dans la conservation des liquides). Cette organisation logique du monde physique par la manipulation concrète et le raisonnement offre un cadre stable pour comprendre la réalité.
6. Le développement affectif et social accompagne les stades cognitifs
Le développement affectif et social de l’enfant suit le même processus général, puisque les aspects affectifs, sociaux et cognitifs du comportement sont en réalité indissociables.
Aspects indissociables. Le développement cognitif (structures) et le développement affectif/social (énergétique) sont deux faces d’une même pièce, progressant parallèlement à travers des stades similaires de décentrement. La capacité à comprendre cognitivement le point de vue d’autrui est liée à la capacité à établir des relations sociales et morales réciproques.
Étapes de l’interaction sociale :
- Adualiste initial (0-2 ans) : absence de différenciation entre soi et autrui, affectivité centrée sur les états corporels.
- Précoopération/Égocentrisme (2-7 ans) : les interactions sociales existent mais sont centrées sur le point de vue propre de l’enfant ; difficulté à coordonner les perspectives dans la communication ou le jeu. Le jugement moral est hétéronome, fondé sur des règles externes et des conséquences objectives.
- Coopération (7-11 ans) : émergence d’une coopération véritable, respect mutuel et coordination des points de vue dans les jeux à règles et les tâches collectives. Le jugement moral devient plus autonome, prenant en compte les intentions et la réciprocité, conduisant à un sens de la justice.
Du respect unilatéral au respect mutuel. Le passage de l’hétéronomie à l’autonomie morale s’accompagne d’un passage du respect unilatéral (fondé sur l’autorité et la contrainte) au respect mutuel (fondé sur la réciprocité et l’estime). Ce décentrement permet une compréhension plus objective des règles et des valeurs sociales, reflétant le décentrement des opérations cognitives.
7. Les opérations formelles permettent un raisonnement abstrait et hypothétique
La grande nouveauté de ce stade est que, par une différenciation de la forme et du contenu, le sujet devient capable de raisonner correctement sur des propositions qu’il ne croit pas, ou du moins pas encore ; c’est-à-dire des propositions qu’il considère comme de pures hypothèses.
Penser les possibles. À partir de 11-12 ans environ, l’adolescent développe la pensée opératoire formelle, qui ne se limite plus aux objets ou événements concrets. Il peut raisonner sur des concepts abstraits, des situations hypothétiques et des propositions verbales, envisageant des possibilités qui peuvent ou non correspondre à la réalité. Cela ouvre la voie au raisonnement hypothético-déductif.
Nouvelles structures logiques. La pensée formelle implique deux avancées structurelles majeures :
- Le système combinatoire : la capacité à considérer systématiquement toutes les combinaisons possibles d’éléments ou de propositions, essentielle pour résoudre des problèmes complexes et pour le raisonnement scientifique.
- Le groupe INRC : une structure intégrant deux formes de réversibilité (inversion/négation et réciprocité/symétrie) en un système unique, permettant des transformations logiques plus flexibles et puissantes.
La libération de la pensée. Ce stade représente un décentrement final et majeur, libérant la pensée des contraintes du concret et de l’immédiat. Cette libération cognitive accompagne l’intérêt croissant de l’adolescent pour les idéaux abstraits, les possibles futurs et le raisonnement théorique, marquant la transition vers les modes de pensée adultes.
8. La préadolescence développe un esprit expérimental spontané
Un aspect remarquable de la pensée à ce stade, largement négligé car l’enseignement traditionnel à l’école l’ignore presque totalement (au mépris des exigences techniques et scientifiques les plus évidentes de la société moderne), est le développement spontané d’un esprit expérimental...
Raisonner sur les variables. Le développement des opérations formelles permet une nouvelle approche de la résolution de problèmes, notamment dans les contextes scientifiques ou expérimentaux. L’adolescent peut désormais tester systématiquement des hypothèses en manipulant des variables et en isolant des facteurs, une compétence largement absente chez les plus jeunes.
Dissociation des facteurs. Confronté à un problème impliquant plusieurs causes potentielles (facteurs), le penseur formel peut :
- Identifier tous les facteurs possibles.
- Formuler des hypothèses sur les facteurs efficaces.
- Concevoir des expériences pour tester chaque facteur indépendamment, en maintenant les autres constants.
- Tirer des conclusions logiques à partir des résultats, confirmant ou infirmant les hypothèses.
Induction et déduction. Ce stade permet une interaction plus sophistiquée entre induction (formuler des lois générales à partir d’observations) et déduction (tester ces lois par inférence logique). Le système combinatoire aide à générer des hypothèses, tandis que le groupe INRC fournit le cadre logique pour les évaluer et comprendre les relations complexes entre variables, telles que les proportions ou l’équilibre.
Dernière mise à jour:
Avis
La psychologie de l’enfant suscite des avis partagés. Nombre de lecteurs la jugent dense, technique et difficile d’accès, surtout pour ceux qui ne sont pas spécialistes. Certains saluent ses éclairages sur les stades du développement cognitif, tandis que d’autres peinent face à un langage parfois désuet et à l’absence d’applications concrètes. Les critiques positives mettent en avant les théories novatrices de Piaget et leur influence majeure sur la psychologie de l’enfant. En revanche, les avis négatifs soulignent la complexité de l’ouvrage et son contenu parfois dépassé. Dans l’ensemble, ce livre est considéré comme une œuvre importante mais exigeante, davantage destinée à un public académique qu’à une lecture de loisir.