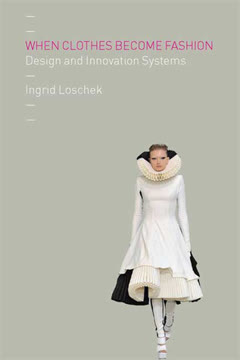Points clés
1. La mode est une construction sociale, pas seulement des vêtements.
Le vêtement est complété par la semblance et l’illusion, définies comme une valeur accrue ou une utilité supplémentaire ; en bref, comme la mode.
Au-delà du simple habit. La mode ne se réduit pas au vêtement ; elle est une construction sociale, fondée sur un accord collectif quant à ce qui est « tendance » ou « démodé ». Si le vêtement remplit des fonctions pratiques telles que la protection ou l’esthétique, la mode lui confère une finalité sociale, le transformant en un signe d’identité et d’appartenance. Cette distinction montre que les changements saisonniers de vêtements ne signifient pas automatiquement des changements de mode.
La validité sociale, un élément clé. Contrairement au vêtement, défini par sa forme durable et son renouvellement saisonnier en termes économiques, la mode tire sa signification fondamentale de ses dynamiques sociales. Sa validité se négocie par la communication au sein de la société, ce qui la rend variable, plurielle et discontinue. Cette négociation sociale permet de redéfinir sans cesse les limites de tolérance, favorisant l’acceptation des créations innovantes et l’émergence de nouvelles modes.
Mise en scène et communication. Le passage du vêtement à la mode commence par sa mise en scène sur les podiums, la photographie et la publicité. Ces médias confèrent au vêtement la « semblance et l’illusion de la mode », le présentant à un public élargi. Ce processus souligne que la mode dépasse largement son apparence ; elle est un jeu complexe de fonction, de sens et de communication sociale, où l’imitation et la diffusion de « mèmes » culturels jouent un rôle essentiel.
2. La mode fonctionne comme un système autoréférentiel.
La mode est un système autoréférentiel centré sur l’auto-organisation et l’auto-reproduction cyclique de ses éléments systémiques.
Dynamiques autonomes. La mode, à l’instar de la politique ou de l’art, opère comme un système social autonome, autoréférentiel et opérationnellement clos, selon la théorie de Niklas Luhmann. Cela signifie que le système de la mode produit la mode de l’intérieur, indépendamment des influences causales externes telles que le système économique. Son noyau existe « en tant que tel », générant constamment de nouvelles créations et perdurant même en période de crise.
Autopoïèse et stabilité. L’auto-organisation du système, ou autopoïèse, garantit son existence continue par la production d’innovations. La stabilité de la mode naît de ses instabilités intrinsèques, créant sans cesse de nouvelles formes et contenus pour éviter l’effondrement. Cette dynamique interne lui permet d’adapter son organisation face aux changements environnementaux, sans être directement contrôlée par eux, illustrant un paradigme de complexité organisée.
Code binaire et liens structurels. La mode fonctionne selon un code binaire « in » et « out », signifiant ce qui est à la mode ou démodé, plutôt que beau ou laid. Bien qu’autoréférentielle, la mode maintient des liens structurels essentiels avec d’autres systèmes sociaux comme l’économie, les médias, la musique et l’art. Cet échange avec son environnement lui permet de refléter l’esprit du temps et de rester dynamique, contrairement aux costumes traditionnels rigides ou aux uniformes.
3. La créativité alimente la réinvention constante de la mode.
La créativité est une qualité naturelle… C’est la capacité d’évolution… En réalité, la créativité humaine est quelque chose de naturel et simple… c’est seulement que l’image que l’homme a de sa propre créativité est trop élevée.
Au-delà des châteaux de sable. La créativité en design de mode dépasse l’ingéniosité quotidienne, impliquant des potentiels conceptuels et de conception originaux. Elle mobilise diverses dispositions cognitives, notamment :
- La pensée analogique et associative
- La curiosité et une imagination foisonnante
- Les capacités constructives et le savoir
Cette interaction complexe permet aux créateurs d’introduire des éléments ou solutions véritablement nouveaux, repoussant les limites du possible en matière de vêtement.
Le rôle du cerveau dans l’innovation. La créativité humaine naît de la communication dynamique entre les hémisphères cérébraux gauche rationnel et droit intuitif. Ce réseau neuronal est essentiel pour des créations innovantes, alliant esthétique remarquable et intégrité structurelle. Contrairement aux ordinateurs, la flexibilité du cerveau humain, sa capacité à penser subjectivement et à prendre des risques sont fondamentales pour générer des idées réellement inédites, opérant dans « l’éventuel ouvert » de la logique floue.
Liberté et frustration. Les conditions préalables essentielles à la production créative incluent la liberté de pensée, d’émotion et d’action. La nécessité paralyse souvent plus qu’elle n’inspire, tandis que la frustration face aux normes existantes peut déclencher des percées créatives. Des créateurs comme Mary Quant, Jil Sander ou Gabrielle Chanel ont révolutionné la mode en exprimant leur insatisfaction du statu quo, donnant naissance à des langages de design uniques et des styles cohérents.
4. L’innovation naît de la provocation et de la transformation.
Le provocateur, le choquant et le radical prennent naissance dans les processus de pensée avant de se concrétiser en quelque chose de tangible et perceptible.
Remettre en cause la perception. La provocation en design de mode modifie consciemment les caractéristiques d’un objet pour générer des conséquences paradoxales, irréalistes ou inhabituelles, visant une perception renouvelée du vêtement et du corps. Cela implique de franchir des frontières réelles et intellectuelles, en déviant des normes perceptuelles et émotionnelles. Alexander McQueen, par exemple, a intégré la provocation en créant un écart marqué entre ses créations et l’image générale du vêtement, exigeant un effort d’interprétation du spectateur.
Surformer et déformer. Les créateurs utilisent des formes extrêmes pour capter l’attention et défier l’esthétique habituelle. La collection « Body Meets Dress » de Rei Kawakubo, avec ses rembourrages asymétriques, déformait le corps pour interroger les idéaux traditionnels de beauté, tandis que Viktor & Rolf, avec « Russian Doll », habillaient une modèle à l’excès jusqu’à l’immobilité, la transformant en objet textile. Ces manipulations extrêmes soulignent le potentiel sculptural du vêtement et sa capacité à redéfinir la silhouette humaine.
Design transformateur. La transformation consiste à modifier une forme ou une structure sans en perdre la substance, dans le but de puiser de nouvelles énergies et d’atteindre de nouveaux objectifs. Cela inclut :
- Soustraction et inversion : « Manifest Destiny » (2003) de Hussein Chalayan avec des filets de tissu, ou « Upside Down » (2006) de Viktor & Rolf inversant haut et bas.
- Expérimentation matérielle : l’usage de plastique dur et métal par Paco Rabanne, ou les tissus dissolvants d’Helen Storey.
- Transformables : la cape de pluie « Habitent » (1992) de Lucy Orta qui devient une tente.
Ces stratégies repoussent les limites du portable, brouillant souvent la frontière entre mode et art.
5. La mode brouille les frontières avec l’art et le design.
L’art est, parce qu’il est art, artificiel et donc extrêmement non naturel.
Le but de l’art et la revendication de la mode. Si l’« art pur » est traditionnellement perçu comme sans finalité et l’« art appliqué » (design) comme fonctionnel, tous deux servent des objectifs d’expression, de décoration ou de communication. La mode s’approche de l’art lorsqu’elle puise dans les idées, émotions et expérimentations, indépendamment de la portabilité ou de la commercialisation. Des créateurs comme Viktor & Rolf ou Hussein Chalayan réalisent des pièces qui transcendent l’utilité commerciale, devenant des « synthèses théâtrales, artistiques et vestimentaires des arts ».
Le vêtement comme medium artistique. Les artistes ont longtemps utilisé le vêtement symboliquement, comme fétiche, substitut ou représentation de l’être humain. Le « Gilet pour Benjamin Péret » (1958) de Marcel Duchamp ou les totems baskets de Brian Jungen en sont des exemples. À leur tour, les créateurs de mode intègrent techniques et concepts artistiques, brouillant les frontières.
- Cindy Sherman et Erwin Wurm adaptent la mode en art pour la critiquer.
- Vanitas, Flesh Dress (1987) de Jana Sterbak utilise la viande crue pour explorer le corps et la décomposition.
Ces œuvres montrent comment art et vêtement construisent et manipulent l’image du corps.
Le design, entre esthétique et fonction. Le design se définit par sa relation entre forme et usage, explorant le « code génétique » d’un objet pour satisfaire des besoins complexes. Un bon design équilibre critères esthétiques, fonctionnels et communicatifs. Le design de mode, en tant qu’art appliqué, vise à rendre les choses compréhensibles et agréables à porter, reflétant « l’âme d’une époque ». Cette convergence se manifeste dans des expositions où la mode de créateur est présentée comme un artefact culturel, distincte du pur commerce, remettant en question le « qui va porter ça ».
6. Le croisement des contextes stimule l’évolution de la mode.
Le nouveau émerge grâce à l’imagination, la capacité de concevoir quelque chose en complément de ce qui existe.
Au-delà des idées originales. Les croisements de contextes, ou « hybrides », sont une stratégie d’innovation puissante en mode, souvent issues de la pensée associative plutôt que d’idées entièrement nouvelles. Ils consistent à construire des relations entre des idées ou structures auparavant déconnectées, conduisant à une revalorisation du sens. On observe cela dans :
- La revalorisation matérielle : Paco Rabanne adaptant métal ou verre pour des robes.
- La recontextualisation culturelle : Coco Chanel transformant une « veste paysanne » régionale en haute couture internationale.
- La réaffectation fonctionnelle : l’anorak passant du vêtement inuit au sportswear mondial.
Assimilation globale. Cette stratégie consiste à assimiler diverses traditions locales et à les recomposer en ensembles nouveaux, accessibles mondialement. Le « look ethno », popularisé par Kenzo ou John Galliano, mêle éléments de cultures variées (péruvienne, mongole, yéménite) en une esthétique multiculturelle. Ce rejet des identités locales strictes, porté par curiosité et ouverture, caractérise la mode postmoderne, créant un « monde sans frontières » en termes de style.
Paradoxe et re-design. Le croisement des contextes intègre aussi le paradoxe, fusionnant contradictions pour créer du neuf. Exemples :
- Moschino inversant l’usage des signes de mode (jeans en veste).
- Gianni Versace avec la collection « Bondage », transformant connotations sadomasochistes en luxe.
- Helmut Lang ornementant minimalement le sportswear avec des éléments de costume.
Ces efforts de « re-design », par ajout, suppression, inversion ou fusion, redéfinissent sans cesse ce qui est considéré comme à la mode et acceptable, donnant naissance à des hybrides comme le pantalon cargo ou les sandales de trekking.
7. La technologie et le corps redéfinissent l’avenir de la mode.
L’expression clé « seconde peau » incarne une vision future où un matériau synthétique semblable à la peau humaine s’intègre à la peau, se répare et repousse, produisant couleurs ou logos directement sur la peau selon son traitement.
Objets connectés et textiles intelligents. L’intégration de l’électronique et des nouvelles technologies dans le vêtement inaugure une ère nouvelle, transformant les habits en « wearables » ou « vêtements intelligents ». Ces objets électroniques fonctionnels, comme les vestes GEOX avec pavés tactiles intégrés ou lecteurs MP3, privilégient la fonction et la performance. La vision s’étend aux textiles réagissant à la lumière, la chaleur ou le toucher, voire auto-réparants, dépassant l’esthétique pour offrir des fonctions largement indépendantes de l’utilisateur.
Cyborgs et bio-design. Le concept de « cyborg » (organisme cybernétique) explore la fusion du biologique et de l’artificiel, repoussant les limites de l’amélioration humaine. Cela inclut :
- Des implants cérébraux pour accroître les capacités cognitives.
- Des bijoux corporels servant d’interfaces cerveau-ordinateur.
- Des prothèses visibles, conçues comme éléments de design, à l’image du travail d’Alexander McQueen.
Cette vision suggère un futur où le corps humain devient un objet de design majeur, brouillant nature et artifice, et conduisant potentiellement à une « bio-machine prête à s’adapter ».
Mode virtuelle et cybercorps. Les avancées numériques permettent la création d’une « mode pour le ‘moi’ virtuel », où avatars dans le cyberespace expriment diverses identités virtuelles. Des créateurs comme Christiane Luible et Alexander Lindt explorent le design corporel pour entités virtuelles sans corps, où le vêtement peut être :
- Un revêtement spatial changeant avec le mouvement virtuel.
- Des fragments errant sur le corps.
- Des nanocomposants d’énergie pure à la surface de la peau.
Ces concepts remettent en cause les notions traditionnelles du vêtement, suggérant un futur où la mode existe au-delà des contraintes physiques, comme matériau de design pur pour le corps, et où le « franchissement de la réalité » devient courant.
8. La copie est essentielle à la diffusion de la mode.
La mode prospère grâce à la copie, entendue comme reproduction d’une œuvre.
Originalité et reproduction. Le concept de « copie » est apparu en mode avec l’essor des créateurs nommés comme Charles Frederick Worth, dont la revendication d’œuvres uniques a engendré l’idée d’imitation. Contrairement aux beaux-arts, la mode dépend de la reproduction pour exister. L’adage « un vêtement ne devient mode que lorsqu’il est porté dans la rue » souligne que l’adoption massive, souvent par copie, est cruciale pour qu’un design devienne « mode ».
De la haute couture au marché de masse. Les copies vont des reproductions légales et patrons de couture aux imitations libres et contrefaçons illégales. Ce processus rend la mode de créateur accessible au grand public, entraînant une certaine homogénéité stylistique saisonnière. Si les créateurs sont inventeurs, les suiveurs habiles réussissent souvent en adaptant des designs extrêmes pour un plus large public et en exploitant la puissance de distribution, stimulant la concurrence et l’expansion du marché.
Authenticité et appropriation. La valeur d’un produit, notamment de luxe, motive souvent la copie, les logos et étiquettes de marque signifiant l’originalité. Cependant, les créateurs pratiquent aussi « l’art de l’appropriation », questionnant la revendication même d’originalité. Martin Margiela, par exemple, déconstruit et recompose des pièces de seconde main, tandis que Gabrielle Chanel accueillait la copie comme une « garantie continue de succès », estimant que seules les créations importantes sont imitées. Ce jeu entre original et copie est fondamental à la dynamique de la mode.
9. La mode reflète et façonne l’identité sociétale.
La mode est une perception esthétique personnelle dans le collectif, car l’individu ne prend sens qu’à travers le tout.
Au-delà du « l’habit fait l’homme ». La mode offre un éclairage sur la société et la culture, servant de symbole d’érotisme, pouvoir, savoir, esthétique, plaisir, goût et prestige. Elle définit l’identité sociale, permettant à chacun d’exprimer son auto-construction vers l’extérieur. Ce positionnement social est crucial, car l’apparence d’une personne, façonnée par vêtements et style, détermine la manière dont elle est adressée et intégrée, faisant d’elle un « adresseur social ».
Individuation et socialisation. Si les individus perçoivent la mode de façon unique, la socialisation l’emporte souvent sur l’individuation. La transmission des traditions conduit à une adaptation ou préservation de l’apparence au sein d’une communauté, assurant la continuité. Les adolescents, en particulier, utilisent le vêtement pour construire une image de soi et signaler l’appartenance à un groupe, souvent par des styles extrêmes ou mimétiques. Cette dualité distinction/imitation est fondamentale dans le rôle de la mode pour la formation identitaire, où l’effort créatif personnel se réduit souvent à combiner des pièces à la mode.
Genre et corps comme constructions sociales. La mode joue un rôle central dans le « faire genre », produisant et renforçant constamment les rôles de genre par le style et la présentation corporelle. Si la neurophysiologie confirme des différences biologiques entre sexes, le genre est largement une construction socioculturelle, intensifiée et rendue visible publiquement par la mode. La polarisation historique des modes masculine et féminine, puis leur brouillage par des styles transgenres, reflètent l’évolution des normes sociétales et la négociation continue de l’identité et de la « performativité ».
10. Les styles évoluent par cycles de modernité et pluralisme.
Le pluralisme stylistique de la mode vestimentaire actuelle s’associe au principe dit postmoderne, à la mascarade [style melting-pot ; note de l’auteur], à la mise en scène à court terme de l’individualité comme concept processuel d’identité fondé sur le schéma oppositionnel « in » et « out » plutôt que « ancien » versus « moderne ».
La rupture moderniste avec la tradition. Le modernisme, surtout au début du XXe siècle, cherchait innovation et progrès par une rupture radicale avec le passé. En mode, cela s’est traduit par :
- Le futurisme italien avec ses couleurs vives et chemises métalliques exaltant la technologie.
- Le constructivisme russe avec ses designs fonctionnels et géométriques pour le prêt-à-porter.
Le
Dernière mise à jour:
Avis
Il semble que le contenu à traduire soit vide. Pourriez-vous me fournir le texte à traduire en français ? Je serai ravi de vous aider.