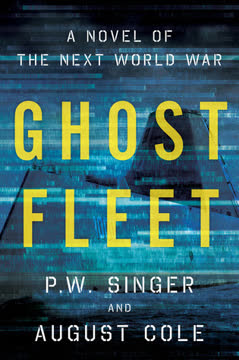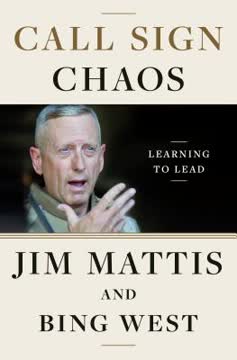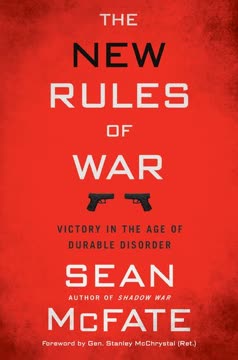Points clés
1. L’Occident Perd les Guerres à Cause d’une Atrophie Stratégique
La dernière fois que les États-Unis ont remporté un conflit de manière décisive, le monde fonctionnait encore aux tubes à vide.
Une réalité sombre. Depuis la Seconde Guerre mondiale, malgré des ressources et une formation sans précédent, l’armée américaine échoue systématiquement à atteindre ses objectifs dans des conflits allant de la Corée et du Vietnam à l’Irak et l’Afghanistan. Ce n’est pas une question partisane, mais un problème américain, révélateur d’un mal plus profond : une conception erronée de la victoire et un refus d’admettre l’échec. L’Occident, y compris le Royaume-Uni et l’OTAN, s’enlise dans des bourbiers, perdant régulièrement face à des ennemis plus faibles.
Une incompétence stratégique. Le problème central ne réside pas dans un manque de troupes supérieures, de technologie ou de budget, mais dans une faille fondamentale de la pensée stratégique. Nombre d’experts sont dans le déni, s’accrochant à des notions dépassées de la guerre ou rejetant le conflit comme trop chaotique pour être compris. Cette « atrophie stratégique » découle d’un désir nostalgique de mener des guerres conventionnelles comme en 1945, ignorant que la guerre a évolué.
Un désordre durable. Le XXIe siècle est marqué par un « désordre durable », un état de chaos perpétuel où les solutions traditionnelles échouent. Les conflits armés ont doublé depuis la Seconde Guerre mondiale, les accords de paix s’effondrent souvent, et d’anciennes divisions se ravivent. Ce n’est pas l’anarchie, mais un retour à une norme pré-westphalienne où le conflit couve sans fin. L’Occident est dangereusement mal préparé, tandis que des adversaires comme la Russie, la Chine et les groupes terroristes exploitent ce désordre en jouant selon des règles nouvelles et non reconnues.
2. La Guerre Conventionnelle est Morte ; Les Conflits Futurs sont Post-Conventionnels
La guerre conventionnelle est morte. Ceux qui restent enfermés dans cette mentalité traditionnelle ne reconnaîtront probablement même pas les conflits futurs comme des guerres, jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
Un modèle obsolète. La stratégie occidentale de « guerre conventionnelle », calquée sur la Seconde Guerre mondiale, suppose un combat entre États où la puissance de feu et la victoire sur le champ de bataille sont souveraines. Cette mentalité de « Grande Guerre », fortement influencée par Carl von Clausewitz, est désormais dépassée. Le traité de Westphalie (1648) avait établi les États comme seuls acteurs légitimes de la guerre, mais cet ordre s’effrite, les États reculant au profit d’autres entités.
Une dangereuse illusion. Malgré les leçons amères du Vietnam, de la Somalie, de l’Irak et de l’Afghanistan, l’Occident continue de concevoir ses armées pour un type de guerre que personne d’autre ne mène. Le nombre de guerres non conventionnelles a fortement augmenté depuis 1945, tandis que les conflits interétatiques conventionnels sont presque éteints. Cette fixation sur le passé assure l’échec, car les ennemis mènent la guerre dans le présent, souvent sans uniformes traditionnels ni lignes de front claires.
Transformer l’armée. Pour gagner, l’Occident doit abandonner son approche dépassée. Cela signifie :
- Cesser d’acheter des armes conventionnelles : Des milliards dépensés pour les F-35 et les porte-avions sont inutiles face aux menaces modernes.
- Investir dans les forces spéciales (FS) : Elles sont efficaces mais sous-financées.
- Rééquilibrer les composantes actives et réserves : Placer les combattants conventionnels en réserve, les fonctions de soutien en service actif.
- Cultiver des guerriers-diplomates : Des individus immergés dans la langue, la culture et la politique locales.
- Renforcer les agences civiles : La domination de l’information, les sanctions financières, la communication stratégique sont cruciales.
3. La Technologie Ne Gagnera Pas les Guerres ; Investissez dans les Hommes et la Ruse
La technologie séduisante ne gagne pas les guerres.
L’utopisme technologique. La foi de l’Occident dans les armements avancés, incarnée par le chasseur F-35 (l’arme la plus chère de l’histoire à 1,5 trillion de dollars), est une forme d’auto-illusion. Malgré ses spécifications impressionnantes, le F-35 n’a effectué aucune mission de combat dans les guerres en cours et peine face à des avions plus anciens. Cette obsession pour le « gadget » au détriment d’outils efficaces est un « utopisme technologique » qui aveugle l’Occident aux réalités du conflit moderne.
Utilité décroissante de la force. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les armées high-tech sont régulièrement déjouées par des adversaires low-tech. La modeste bombe artisanale sur le bord de la route surpasse souvent les « armes intelligentes », et le fusil AK-47 reste la véritable arme de destruction massive par nombre de victimes. La « Troisième Stratégie de Compensation », promettant la victoire par la robotique et l’IA, est un redémarrage de théories ratées des années 1990, ignorant que la technologie n’est plus décisive en guerre.
Investir dans la matière grise. La collision du USS Fitzgerald, causée par un personnel non formé malgré des systèmes avancés, souligne le danger d’une dépendance excessive à la technologie au détriment des compétences humaines fondamentales. Les guerres futures seront low-tech, les ennemis armant le banal. La solution est d’investir dans les hommes, pas dans les plateformes, en reconnaissant que l’intelligence et l’adaptabilité humaines surpassent le silicium.
4. Guerre et Paix Coexistent ; Exploitez la « Zone Grise »
Des adversaires rusés tirent parti de l’espace entre guerre et paix pour des effets dévastateurs.
Des lignes floues. La dichotomie occidentale traditionnelle « guerre ou paix » est une illusion dangereuse. Des adversaires comme la Russie et la Chine exploitent la « Zone Grise » — l’espace entre guerre déclarée et paix formelle — pour atteindre des objectifs stratégiques sans déclencher de réponse militaire conventionnelle. La « guerre de nouvelle génération » russe en Ukraine et la stratégie des « Trois Guerres » chinoises en mer de Chine méridionale en sont des exemples emblématiques.
La guerre par d’autres moyens. La stratégie chinoise vise, par exemple, à saper la volonté de combattre de l’ennemi avant même le début des combats, en utilisant :
- La guerre psychologique : tromperie stratégique, rumeurs, fausses narrations, pression diplomatique.
- La guerre médiatique : manipulation de l’opinion publique via des médias d’État (CCTV) et influence à Hollywood.
- Le droit de la guerre (lawfare) : déformer ou réécrire le droit international pour renforcer des revendications territoriales et miner la légitimité des adversaires.
Une paralysie stratégique. La vision binaire occidentale de la guerre (allumée ou éteinte) la rend stratégiquement inerte face à ces guerres non-guerres. Tandis que les États-Unis construisent plus d’armes conventionnelles, la Chine s’empare d’îles et sape les alliances. Cela souligne l’urgence d’une nouvelle grande stratégie reconnaissant la coexistence constante de guerre et paix, permettant une action proactive dans la Zone Grise plutôt que d’attendre une déclaration formelle d’hostilités.
5. « Cœurs et Esprits » Ne Comptent Pas ; Une Contre-Insurrection Efficace est Brutale
Gagner les cœurs et les esprits, telle que l’Occident conçoit aujourd’hui la contre-insurrection, est sans pertinence.
Une doctrine ratée. La stratégie de contre-insurrection (COIN) « centrée sur la population », popularisée par le général David Petraeus, promettait la victoire en séduisant les populations locales par la construction nationale et les services sociaux. Cette approche a échoué spectaculairement en Irak et en Afghanistan, car elle supposait à tort que les populations sont corruptibles et que les concepts occidentaux de légitimité s’appliquent universellement.
Une brutalité historique. Les stratégies COIN efficaces dans l’histoire ont été bien plus impitoyables :
- Assécher le marais : contraindre ou éliminer la population soutenant les insurgés, comme Rome en Judée.
- Exporter et déplacer : disperser de force des groupes ethniques pour éteindre la rébellion, à l’image de Staline avec les Tchétchènes.
- Importer et diluer : inonder une région de sa propre population pour réprimer la résistance locale, comme la Chine au Tibet.
Un choix cornélien. Une COIN efficace est brutale et sans cœur, souvent proche du colonialisme. Tandis que l’Occident rechigne à ces méthodes, son approche actuelle ne fait que prolonger les conflits et permettre au terrorisme et aux insurgés de prospérer. L’alternative est d’accepter qu’une présence robuste et durable est nécessaire, mais sans risquer les soldats occidentaux en sacs mortuaires.
Former une Légion étrangère. La solution est de créer des légions étrangères, à l’image de celle de la France, composées de recrues mondiales encadrées par des officiers occidentaux. Ces unités permettraient :
- D’assurer une présence durable sur le terrain dans les régions instables.
- De réduire les pertes occidentales, offrant une liberté politique de manœuvre.
- De remplacer les milices proxies peu fiables et les contractants privés irresponsables.
- D’offrir une voie vers la citoyenneté, attirant des recrues dévouées.
6. Les Mercenaires Sont de Retour et Redéfinissent la Guerre
Les mercenaires sont de retour. Je le sais, car j’en ai été un.
La deuxième plus vieille profession. Les mercenaires, ou « sociétés militaires privées », ne sont pas une nouveauté mais un retour à la norme historique. Pendant la majeure partie de l’histoire, louer la force était moins coûteux que la posséder, et les mercenaires étaient l’instrument principal de la guerre. L’ordre westphalien les avait temporairement réprimés, mais ils ont refait surface, notamment après les guerres américaines en Irak et en Afghanistan.
Un marché florissant et non régulé. Plus de la moitié des personnels militaires dans les récentes guerres américaines étaient des contractants, une proportion en hausse. Cela a créé un marché mondial de plusieurs milliards pour la force privée, avec des entreprises comme le groupe russe Wagner opérant avec une efficacité létale. Ce marché est largement non régulé, sans juridiction internationale ni force policière pour faire respecter les lois, entraînant :
- Un risque moral : les clients sont plus imprudents quand leurs propres soldats ne saignent pas.
- Un allongement des conflits : les mercenaires ont intérêt à déclencher et prolonger les guerres pour le profit.
- Des dilemmes sécuritaires : la prolifération de la force privée provoque des courses aux armements et des escalades accidentelles.
- Des trahisons : les conflits se règlent par la perfidie, non par la loi.
L’inutilité du droit. Les tentatives d’interdire ou de réguler les mercenaires ont largement échoué. Beaucoup d’acheteurs sont des États, rendant les poursuites difficiles, et les acteurs non étatiques se déplacent simplement offshore. Le marché de la force est là pour durer, et sa logique — Clausewitz rencontre Adam Smith — déformera profondément la guerre, la rendant moins politique et plus économique.
7. De Nouveaux Pouvoirs Non-Étatiques Régneront et Mèneront des Guerres Sans États
Quand les super-riches peuvent louer des armées, ils deviennent une nouvelle sorte de superpuissance, capable de défier les États et leur ordre fondé sur des règles.
Le recul des États. Beaucoup des 194 États du monde sont fragiles ou en déliquescence, créant un vide d’autorité. Cette érosion du pouvoir étatique favorise l’émergence de nouveaux acteurs globaux qui combleront ce vide, notamment :
- Insurgés et califats : comme l’État islamique, établissant un pouvoir de facto.
- Corporatocraties : des multinationales embauchant leurs propres armées pour protéger leurs actifs dans des régions dangereuses.
- Narco-États : des cartels de drogue devenant des gouvernants de facto, comme à Acapulco au Mexique.
- Royaumes de seigneurs de guerre : des individus s’emparant du pouvoir et gouvernant des territoires.
- Seigneurs mercenaires : des capitaines mercenaires s’installant comme dirigeants, court-circuitant les intermédiaires.
La nouvelle élite. Le 1 % mondial et les mégacorporations, déjà plus puissants économiquement que beaucoup d’États, peuvent désormais louer une puissance de feu industrielle. Cette marchandisation de la guerre signifie que milliardaires, mégachurches et ONG pourraient lancer leurs propres « croisades » ou interventions humanitaires, contournant les acteurs étatiques traditionnels. La Compagnie britannique des Indes orientales est un précédent historique d’une entreprise détenant un pouvoir militaire immense.
Les États profonds. Au-delà de ces acteurs externes, les « États profonds » — alliances institutionnelles au sein d’un gouvernement (militaire, renseignement, justice) opérant hors du contrôle démocratique — émergent aussi comme de nouvelles superpuissances. Ce ne sont pas des conspirations, mais des structures établies qui privilégient leurs intérêts propres, comme on le voit en Turquie, en Iran, et même dans le complexe militaro-industriel américain. Leur dévoilement accélérera le désordre durable.
8. Les Guerres de l’Ombre Domineront, Portées par la Tromperie et l’Information
La dénégation plausible est plus décisive que la puissance de feu à l’ère de l’information.
La guerre souterraine. Les conflits futurs se dérouleront de plus en plus dans l’ombre, où la dénégation plausible est le centre de gravité. Les grandes batailles de chars sont dépassées ; les guerriers masqués, forces spéciales, mercenaires et milices proxies sont à l’honneur. Cela rend la guerre « épistémologique » — la capacité à distinguer le vrai du faux déterminera vainqueurs et vaincus.
La désinformation comme arme. La stratégie russe de « maskirovka » (mascarade) en Ukraine, utilisant les « petits hommes verts » et niant leur présence, en est l’exemple. La Russie est devenue une « superpuissance de la désinformation », employant des « mesures actives » comme la chaîne RT et les « usines à trolls » pour manipuler l’opinion publique et semer la discorde dans les démocraties. L’objectif est de créer un « brouillard de guerre » si épais que la communauté internationale ne peut établir les faits de base, empêchant ainsi toute intervention.
Les arts sombres. La sagesse ancienne de Sun Tzu, « Toute guerre est fondée sur la tromperie », est plus pertinente que jamais. L’« approche indirecte » vise à déjouer l’ennemi, le poussant à commettre des erreurs stratégiques. Cela exige la suprématie de l’information et un esprit rusé plutôt que martial. L’Occident, avec son aversion pour la « manipulation des connaissances », est désavantagé, mais doit apprendre à combattre dans l’ombre sans sacrifier ses valeurs démocratiques.
La guerre de l’ombre occidentale. Les démocraties doivent développer leur propre version de la guerre de l’ombre, adaptée pour saper les autocraties. Cela inclut :
- Des outils cinétiques : forces non attribuables pour des opérations « zéro empreinte » ou sous faux drapeau.
- Des outils non cinétiques : information armée (trolls, bots, soutien secret à la dissidence, campagnes de dénigrement contre les autocrates).
- La pression économique : sanctions contre les élites, effondrement des prix du pétrole, facilitation de la kleptocratie pour éroder la gouvernance.
- L’engagement diplomatique : communication avec tous les acteurs pertinents, y compris non étatiques.
9. La Victoire est Fongible et S’Obtient par la Ruse, Pas Seulement par la Force
Le suprême art de la guerre est de soumettre l’ennemi sans combattre.
Au-delà de la victoire sur le champ de bataille. L’obsession occidentale pour la victoire tactique, illustrée par la bannière « Mission Accomplie » en Irak, est un vestige de la pensée de guerre conventionnelle. La victoire est fondamentalement politique, non purement militaire. Comme l’a montré la guerre du Vietnam, gagner chaque engagement tactique ne signifie rien si les objectifs stratégiques ne sont pas atteints. Les Nord-Vietnamiens ont gagné en utilisant l’information et en érodant la volonté politique américaine, pas en battant militairement l’armée américaine.
Les faibles battent les forts. Des stratégies astucieuses permettent aux faibles de vaincre les forts, surtout lorsque ces derniers sont :
- Une armée conventionnelle nombreuse.
- Un envahisseur étranger.
- Trop étirés.
- Lents à s’adapter.
- Engagés dans une guerre de choix.
Inversement, les faibles gagnent s’ils luttent pour leur survie, sont unis, peuvent compter sur des populations sympathiques, et sont prêts à saigner. La « stratégie fab
Dernière mise à jour:
Avis
Les nouvelles règles de la guerre propose une analyse audacieuse du conflit moderne, affirmant que les tactiques militaires conventionnelles sont désormais dépassées. McFate soutient que les guerres à venir seront dominées par des mercenaires, des conflits clandestins et des acteurs non étatiques. Si certains saluent la perspective innovante et les idées stimulantes du livre, d’autres reprochent des incohérences et une certaine arrogance. L’auteur insiste sur la nécessité de s’adapter aux nouvelles formes de guerre et d’investir dans des stratégies non conventionnelles, un message qui trouve un écho auprès de nombreux lecteurs, même si certains remettent en question la pertinence d’abandonner totalement les approches militaires traditionnelles.
Similar Books