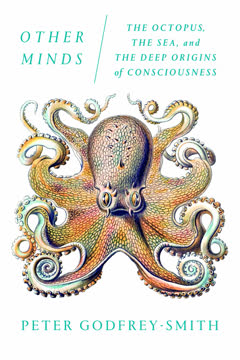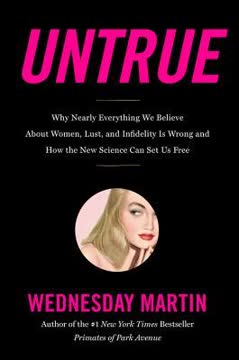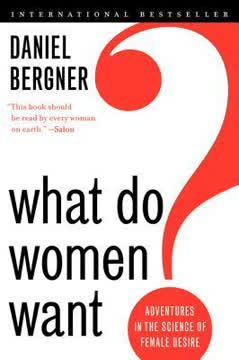Points clés
1. Le désir féminin : plus animal et omnivore qu’on ne le croit
Contempler les données recueillies par le pléthysmographe, c’était faire face à une vision d’excitation anarchique.
L’excitation cachée. Les recherches pionnières de la psychologue Meredith Chivers, utilisant un pléthysmographe mesurant le flux sanguin vaginal, ont révélé l’excitation physiologique des femmes. Ses études ont montré que les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle déclarée, manifestaient une excitation génitale importante face à une large palette de stimuli, incluant du porno hétérosexuel, lesbien, gay masculin, voire des scènes de bonobos. Cette « excitation anarchique » contredisait la croyance commune selon laquelle le désir féminin serait étroitement ciblé.
Au-delà des catégories. Contrairement aux hommes, dont l’excitation physiologique est « spécifique à une catégorie » (les hommes hétérosexuels excités par les femmes, les hommes gays par les hommes), le corps des femmes répondait sans discrimination. Cela suggère une réactivité sexuelle plus primitive, moins sélective, à un niveau biologique. Ces résultats remettent en question l’idée que le désir féminin serait naturellement réservé ou lié uniquement à certains types de partenaires.
Vérités primordiales. Le travail de Chivers visait à éliminer les influences culturelles pour appréhender le « moi primal et essentiel » des femmes. Le pléthysmographe offrait un aperçu de ces vérités sexuelles fondamentales, indiquant que le désir féminin est une force sous-estimée et bridée, bien plus vaste et « animale » que ne le laissent penser les normes sociales.
2. Le décalage corps-esprit : l’excitation féminine souvent dissimulée au grand jour
L’esprit nie le corps.
Subjectif versus objectif. Les expériences de Chivers ont révélé un décalage saisissant entre l’excitation physiologique des femmes (mesurée par le pléthysmographe) et leurs sensations subjectives rapportées (notes sur un clavier). Alors que leurs organes génitaux montraient des réponses fortes et non discriminantes à divers extraits pornographiques, les femmes déclaraient souvent une indifférence ou une moindre excitation, notamment face à des scènes gays masculines ou de bonobos. Ce « décalage corps-esprit » n’était pas observé chez les hommes, dont les déclarations concordaient généralement avec leurs réponses physiologiques.
Influence sociétale. Cette dissonance suggère que les femmes peuvent consciemment minimiser ou inconsciemment refouler leur véritable excitation sous la pression sociale. L’étude de la psychologue Terri Fisher, dite du « faux polygraphe », a renforcé cette idée : les femmes déclaraient un nombre bien plus élevé de partenaires sexuels et de masturbations lorsqu’elles croyaient que leurs réponses étaient vérifiées, témoignant d’un fort désir de se conformer aux normes de modestie perçues.
Architecture cachée. L’« architecture cachée » inhérente aux organes génitaux féminins, comparée à la visibilité évidente de l’érection masculine, pourrait contribuer à ce décalage, rendant les femmes moins conscientes de leurs sensations physiques. Ce phénomène résulte à la fois de prédispositions génétiques et d’un conditionnement culturel, où les filles apprennent à maintenir une distance psychique avec leur corps.
3. Les chaînes sociales : la culture réprime et transforme le désir féminin
Être un être humain sexuel, autorisé à l’être, est une liberté accordée bien plus facilement aux hommes qu’aux femmes.
Répression historique. Au fil de l’histoire, le désir féminin a été à la fois célébré et redouté, conduisant souvent à sa répression. De la représentation d’Ève comme « porte du diable » à la négation farouche de la sexualité féminine à l’époque victorienne, les récits culturels ont constamment cherché à contrôler et diminuer l’agence érotique des femmes. Ce contexte historique façonne encore les attitudes contemporaines, où la luxure féminine demeure suspecte.
Contraintes modernes. Même en des temps apparemment libérés sexuellement, la pensée victorienne persiste, subtile mais essentielle. Les mouvements évangéliques prônant la pureté, la protection sexuelle laïque des filles, et les théories d’une psychologie évolutionniste largement acceptées mais peu étayées contribuent à un environnement culturel encourageant la modestie et la retenue féminines. Cela crée une « sexophobie » intériorisée jusque par les chercheurs.
Le facteur « Beurk ». Meredith Chivers se souvient d’un moment marquant en cours universitaire où des femmes réagissaient avec dégoût (« Beurk ! ») à un gros plan sur une vulve, mais pas à un pénis. Cette réaction viscérale, note-t-elle, exprime une longue histoire d’« interdits et de perspectives restrictives sur la sexualité féminine ». L’existence même de ces barrières omniprésentes témoigne, selon elle, de la puissance immense du désir féminin sous-jacent.
4. La « fable sexuelle » : le récit trompeur de la psychologie évolutionniste sur les femmes
Les éclairages sexuels de la psychologie évolutionniste peuvent parfois sembler n’être qu’une fable conservatrice, conservatrice peut-être involontairement mais néanmoins préservatrice dans l’esprit, protectrice d’un statu quo sexuel.
Théorie de l’investissement parental. La psychologie évolutionniste dominante, notamment la « théorie de l’investissement parental » de David Buss, postule que les hommes sont programmés pour rechercher de multiples partenaires (grâce à un sperme illimité) tandis que les femmes seraient sélectives (en raison d’ovules limités et d’un investissement reproductif élevé). Cette théorie, largement intégrée dans la sagesse populaire, suggère que la libido masculine débridée et la modestie féminine sont génétiquement codées et universelles.
Fondement fragile. Cette théorie repose sur des bases précaires, car elle minimise l’impact profond de l’apprentissage social et du conditionnement culturel. La célébration mondiale de la promiscuité masculine et de la modestie féminine pourrait refléter des cultures dominées par les hommes et une peur historique de la sexualité féminine, plutôt que des vérités biologiques immuables. La théorie sert à préserver un « statu quo sexuel » en qualifiant les différences observées de « naturelles ».
Science trompeuse. Les ouvrages de psychologie populaire utilisent souvent des IRMf pour « prouver » ces théories évolutionnistes, prétendant montrer des différences innées comme le « cerveau féminin » « conçu pour la connexion » et le « cerveau masculin » pour les « frénésies ». Pourtant, les neuroscientifiques confirment que la technologie IRMf n’est pas assez précise pour cartographier une neurologie émotionnelle aussi complexe, et que l’expérience modifie constamment les systèmes neurologiques, rendant les affirmations définitives sur les différences innées entre sexes prématurées et souvent trompeuses.
5. Nouveauté et dominance : le comportement des primates révèle des désirs féminins méconnus
Les femelles de macaques rhésus sont très xénophobes envers les autres femelles... Mais envers les mâles, elles manifestent une préférence pour la nouveauté.
Femmes initiatrices. Les décennies de recherches de la primatologue Kim Wallen sur les macaques rhésus ont montré que les femelles sont les principales initiatrices sexuelles, poursuivant agressivement les mâles et manifestant un fort « biais pour la nouveauté » dans le choix des partenaires. Cela contredit les vues scientifiques antérieures qui dépeignaient les femelles comme passives, une erreur attribuée par Wallen aux préjugés des scientifiques masculins et à leurs observations en cages trop petites.
Rats guidées par le plaisir. Les travaux du neuroscientifique Jim Pfaus sur les rats, s’appuyant sur les découvertes de Martha McClintock, ont démontré un désir féminin actif. Les femelles sollicitent le sexe par des comportements spécifiques (sauts, mouvements rapides) et contrôlent le rythme des accouplements pour prolonger le plaisir et augmenter les chances de conception. Les expériences ont montré que les femelles choisissaient une chambre éclairée et dangereuse si elle était associée à un sexe satisfaisant, témoignant d’un puissant désir de gratification immédiate.
Importance du clitoris. La « diminution volontaire » historique du clitoris dans les études anatomiques, malgré sa structure interne étendue (cartographiée par Helen O’Connell), reflète un biais scientifique plus large à ne pas reconnaître la profondeur du plaisir féminin. Les comportements actifs et hédonistes des femelles primates et rongeurs, conjugués à la réalité anatomique du clitoris, suggèrent que le désir féminin est bien plus puissant et avide de nouveauté qu’on ne le suppose communément chez l’humain.
6. Le noyau narcissique : le désir des femmes d’être désirées
Être désirée était au cœur du désir féminin.
L’attrait d’être convoitée. La psychologue Marta Meana soutient que le narcissisme, au sens descriptif et non péjoratif, est au centre de la psyché sexuelle féminine. Les femmes sont érotiquement excitées par le sentiment d’être intensément désirées, s’imaginant souvent leur corps comme l’objet d’un désir masculin débordant. Cela se manifeste dans leurs mouvements oculaires, qui se portent autant sur les visages masculins (expressions du désir) que sur les corps féminins (chair désirée).
La distance alimente la luxure. Meana affirme que la luxure requiert une certaine distance, non la proximité. L’idéal romantique populaire de « fusion » avec un partenaire ou d’être « complétée » par lui peut étouffer l’éros, car il supprime la séparation nécessaire à l’élan du désir. Pour les femmes, la flamme d’être désirée peut s’éteindre dans les relations longues, car le partenaire ne fait plus un « choix » motivé par un besoin incontrôlable.
Le fantasme de la ruelle. La scène controversée de Meana, où une femme est « ravie » par un homme submergé par le désir, symbolise cette luxure féminine ultime. Sans cautionner la violence réelle, ce fantasme souligne le désir d’être tellement désirée de manière unique et incontrôlable que l’agresseur transgresse toutes les règles. Ce fantasme de « soumission », souvent enraciné dans une volonté d’échapper à la culpabilité ou aux contraintes sociales, offre paradoxalement un sentiment de contrôle par le fait d’être totalement désirée.
7. Le paradoxe de la monogamie : un défi, non une évidence naturelle, pour la libido féminine
L’idée que la monogamie sert la sexualité naturelle des femmes n’est peut-être pas exacte.
Désir en déclin. Nombre d’experts, dont la psychologue Lori Brotto et la primatologue Kim Wallen, suggèrent que la monogamie agit comme une « cage culturelle » pour la libido féminine. Les recherches indiquent que le désir des femmes tend à s’étioler plus rapidement que celui des hommes dans les relations engagées, conduisant souvent à un « trouble du désir sexuel hypoactif » (TDSH), que Brotto qualifie d’« anomalie normale » dans les couples de longue durée.
Ennui et familiarité. Le problème vient souvent de l’ennui et de la perte de nouveauté, plutôt que de troubles hormonaux ou relationnels. Si l’intimité est valorisée, elle ne déclenche ni ne soutient de manière fiable la luxure. Le sentiment d’être « piégée » ou de ne plus être choisie de façon unique par un partenaire peut diminuer le besoin narcissique d’être désirée, essentiel à l’excitation féminine.
Arguments évolutionnistes contraires. Les travaux de la primatologue Sarah Blaffer Hrdy sur la promiscuité féminine chez d’autres espèces (par exemple, les singes masquant la paternité, les scorpions cherchant de nouveaux partenaires) suggèrent une prédisposition évolutive contre la monogamie stricte chez les femelles. Elle avance que l’orgasme féminin, souvent nécessitant une stimulation prolongée, aurait évolué pour encourager un comportement « libertin », assurant une diversité de spermes et de meilleurs résultats reproductifs, remettant en cause l’idée d’une monogamie naturelle chez les femmes.
8. L’énigme de l’orgasme : au-delà du clitoris, un paysage complexe et débattu
La grande question jamais résolue… est : que veut une femme ?
L’héritage freudien. Sigmund Freud affirmait de manière controversée que les orgasmes « mûrs » des femmes étaient vaginaux, rejetant la stimulation clitoridienne comme « immature ». Cela a conduit des décennies de femmes à s’entraîner à atteindre l’orgasme vaginal et des chercheurs comme Marie Bonaparte à tenter des modifications chirurgicales pour atteindre ce but insaisissable. Ce biais historique a profondément influencé la compréhension du plaisir féminin.
Le débat sur le point G. La découverte et la popularisation du point G par Beverly Whipple dans les années 1980 ont déclenché un vif débat, proposant une zone vaginale interne capable d’orgasmes extraordinaires. Malgré la controverse persistante et des études comme celle sur des jumeaux (suggérant qu’il ne s’agit pas d’une entité anatomique distincte), les recherches de Komisaruk et Whipple sur des femmes paraplégiques (qui éprouvent des orgasmes vaginaux malgré des lésions de la moelle épinière) suggèrent que des voies nerveuses distinctes (hypogastrique et vague) contournent la moelle, menant à des sensations internes « plus profondes ».
Multiples voies. La science moderne reconnaît désormais que l’orgasme féminin peut provenir de diverses sources, incluant le clitoris externe, la stimulation vaginale (impliquant potentiellement des extensions clitoridiennes ou la muqueuse urétrale), voire le col de l’utérus. La complexité de ces « quatre orgasmes » souligne la mécanique complexe et encore largement mystérieuse du plaisir féminin, défiant les explications simplistes ou uniques.
9. La quête de l’aphrodisiaque : la science aux prises avec la chimie insaisissable du désir
Il existe un biais, un biais contre — une peur de créer la femme sexuellement agressive. Il y a cette idée d’un effondrement sociétal.
La course au « Viagra féminin ». Les laboratoires pharmaceutiques ont investi des milliards pour développer un « Viagra féminin », visant à guérir le problème répandu du déclin du désir féminin, surtout dans les relations longues. Pourtant, des médicaments comme Intrinsa, Libigel (à base de testostérone), Flibanserin et Bremelanotide ont largement échoué à obtenir l’approbation de la FDA en raison d’une efficacité inconstante, d’effets secondaires ou d’un effet placebo tout aussi puissant.
Confusion hormonale. La science de la biochimie sexuelle féminine reste imprécise. Le rôle de la testostérone, par exemple, est déroutant : son ajout n’augmente pas systématiquement le désir, et sa diminution (par exemple via la pilule contraceptive) ne le réduit pas toujours. Cette « confusion » souligne que le désir échappe souvent aux explications physiologiques simples, suggérant une interaction complexe avec des facteurs psychologiques et sociaux.
Peur de la luxure féminine. Au-delà des obstacles scientifiques, un « biais » important et une « peur de créer la femme sexuellement agressive » ont influencé le développement des médicaments et leur examen par la FDA. Les laboratoires craignaient que leurs aphrodisiaques soient « trop efficaces », provoquant un « effondrement sociétal » si les femmes devenaient « nymphomanes ». Cette anxiété culturelle sous-jacente face au désir féminin débridé impacte même la recherche de son amélioration chimique.
10. Le pouvoir du fantasme : libérer la luxure latente et reprogrammer le cerveau
Cinquante nuances active toute la soupe neurochimique du désir.
Le fantasme comme carburant. Pour de nombreuses femmes, le fantasme est un outil crucial pour accéder et intensifier le désir, surtout lorsque l’excitation physique est lointaine ou dans les relations longues. Qu’il s’agisse d’imaginer une « approche maraudeuse », une rencontre avec une célébrité ou des scénarios explicites issus de la « porno-maman » comme Cinquante nuances de Grey, ces paysages mentaux peuvent enflammer puissamment la luxure.
Activation neurochimique. Le neuroscientifique Jim Pfaus explique que ces fantasmes activent la « soupe neurochimique du désir » du cerveau, en particulier la dopamine, principal vecteur du désir. Cette stimulation mentale peut entraîner excitation physiologique et orgasme, même en l’absence de contact physique, comme le démontrent les femmes capables de « s’auto-conduire à l’orgasme » par la pensée.
Arborisation dendritique. Une pratique régulière du fantasme peut conduire à une « arborisation dendritique », où les réseaux neuronaux du désir deviennent plus denses, plus sensibles et plus facilement activables. Cela suggère qu’entretenir activement pensées et fantasmes érotiques peut, avec le temps, reprogrammer le cerveau, augmentant potentiellement la réceptivité globale et rendant les femmes « au moins un peu plus enthousiastes » envers leurs partenaires, même si la réalité est moins excitante.
Dernière mise à jour:
Avis
Que veulent les femmes ? examine la sexualité féminine à travers des recherches scientifiques et des récits personnels. Les critiques ont jugé l’ouvrage stimulant, bien que perfectible, saluant sa remise en question des idées reçues sur le désir féminin tout en déplorant une organisation parfois confuse et un style d’écriture inégal. Nombreux sont ceux qui ont apprécié les éclairages apportés sur des thèmes tels que la monogamie, l’excitation ou les fantasmes, même si certains ont regretté l’absence de réponses nettes. Dans l’ensemble, ce livre constitue une introduction accessible à un sujet complexe, bien que les avis divergent quant à son efficacité et à ses conclusions.
Similar Books